Evaluation externe finale du projet triennal « Sur la piste du Caméléon » 2022-2025
DETAILS DU PROJET
| NOM DU PROJET | « Sur la piste du Caméléon » : structuration d’un grand itinéraire culturel en faveur des populations locales du Sénégal Oriental |
| ZONE DU PROJET | Sénégal, région de Kédougou |
| PARTENAIRES DU PROJET | Coopération décentralisée Conseils Départementaux de l’Isère et de Kédougou ; Départements de Salémata et de Saraya ; Communes et villages traversés par l’itinéraire ; Agence Régionale de Développement ; Centre Culturel Régional ; Village Communautaire de Bandafassi ; Université de la Huelva ; Compagnie des Inachevés ; le Musée Dauphinois ; Vision du Monde ; COS38 |
| MEMBRES DU CONSORTIUM | Aide Médicale et Développement Association des Minorités Ethniques Energie Sans Frontières Hydraulique Sans frontièresTétraktys |
| REFRENCE DU PROJET | Convention AFD n°CSN 1754 01 J |
| DUREE DU PROJET | 36 mois : du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2025 |
| BUDGET DU PROJET ET FINANCEMENTS | 1 443 000 €AFD, Ambassade de France, coopération décentralisée Isère-Kédougou, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, Régie des eaux Gessiennes, fondations privées (Artelia, Anber, EDF, Schneider Electric) |
1. PRESENTATION DU PROGRAMME
Contexte :
Le Sénégal Oriental regorge de richesses naturelles, culturelles et patrimoniales et est reconnu doublement patrimoine mondial de l’UNESCO. Cependant, malgré cette singularité, les populations de ce territoire sont confrontées aux aléas du changement climatique, à l’augmentation de l’exploitation des gisements aurifères et par l’effritement de certains rites et traditions.
« Sur la piste du Caméléon » est un programme de développement rural dans la région de Kédougou au Sénégal. La structuration d’un grand itinéraire culturel est une évidence pour tous. Il permettra de valoriser et promouvoir les territoires et le patrimoine de ces ethnies, de mettre en lumière les richesses et la singularité de territoire, de favoriser les échanges et les interactions entre les communautés. Le patrimoine est au cœur de ce programme comme vecteur de développement économique, d’amélioration des conditions de vie, de lien social et de gouvernance territoriale.
Il s’agit également d’un programme de développement rural mené par un consortium d’associations françaises et sénégalaise (Aide Médicale et Développement, Association des Minorités Ethniques, Energies Sans Frontières, Hydraulique Sans Frontières et Tetraktys).
L’objectif est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations du Sénégal Oriental en permettant la préservation des patrimoines et la transmission des savoirs.
Pour cela, le programme est structuré en trois grands axes :
- Le développement de nouvelles activités économiques et sociales
Il s’agit ici de définir le tracé de l’itinéraire culturel et d’en réaliser les premiers aménagements, mais également de soutenir et accompagner le développement de différences initiatives relatives aux activités agroécologiques, touristiques et culturelles et génératrices de revenus.
- La préservation et valorisation des patrimoines naturels et culturels
Bénéficiant directement à 15 000 habitants de la région et indirectement à 90 000 habitants, l’accès aux services de santé, d’eau et d’électricité seront renforcés sur 3 pôles ressources, regroupant en un même lieu les différentes infrastructures de base et en développant une activité génératrice de revenus, ici via le tourisme. A travers des programmes de formation et sensibilisation d’acteurs clés et de la population, la connaissance et la valorisation des richesses naturelles et des patrimoines culturels matériels et immatériels sont partagées au grand public, population locale comme touristes.
- La consolidation de la gouvernance locale
Afin d’assurer la mise en place d’une gestion partagée de ce territoire au long terme, il est nécessaire d’améliorer et structurer la gouvernance locale. Cela passe par le renforcement de la structuration et la professionnalisation de l’AME et la mise en place des prémices d’une gouvernance de l’itinéraire culturel.
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats et activités prévues :
| OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : R.1.1 Un itinéraire culturel est identifiéDéfinition du tracé, des étapes principales et de la charte graphique de l’itinéraire ; Aménagement d’un tronçon pilote de l’itinéraire ; Conception du calendrier culturel et d’outils de promotionR1.2 De nouvelles activités s’implantent sur le territoireCréation d’un fonds d’appui au développement des activités agroécologiques ; Création d’un fonds d’appui au développement d’activités culturelles ; Création d’un fonds d’appui au développement d’activités touristiquesR1.3 Les activités accompagnées sont promues et valoriséesMise en réseau des lauréats des fonds, formations et accompagnement ; Création de lieux collectifs adaptés aux activités soutenues ; Appui à la commercialisation des activités des lauréats des fonds Indicateurs de suivi : L’itinéraire culturel est tracé et cartographié ; 1 charte graphique est créée et déclinée ; au moins 50 km d’itinéraires de randonnée et 3 sites sont aménagés ; Au moins 12 rencontres de médiation; Création de 3 outils de promotion de la destination ; 10 tour-opérateurs participent à un éductour ; Au moins 25 initiatives permettant le développement d’activités sont soutenues ; Les 25 lauréats des fonds participent à 2 ateliers de mise en réseau et 3 ateliers de renforcement de compétences ; 1 lieu collectif de vente et de promotion est mis en place ; la création d’1 marque/label est initiée afin de promouvoir les produits et services accompagnés. Indicateurs de résultats : 3000 voyageurs découvrent l’itinéraire culturel « Sur la piste du Caméléon » ; 30 habitants de la région de Kédougou développent des activités génératrices de revenus et retrouvent un attachement à leur territoire d’origine OBJECTIF SPECIFIQUE 2 :R.2.1 Des sites pilotes permettant l’accès aux services et aux ressources de façon durable sont aménagés. Construction et équipement de « Pôles Ressources » ; Mise en place et formation de comités de gestion des infrastructures ; Mise en place de sessions de formations spécifiques (santé, eau, énergie, équipements et accueil touristique)R.2.2Le patrimoine naturel est préservé et valorisé. Réalisation d’une étude environnementale et d’une étude d’impacts ; Mise en place d’un programme de sensibilisation à l’environnement ; Formation des communautés/guides à la connaissance et à la valorisation des ressources naturellesR.2.3Le patrimoine culturel, matériel et immatériel des Ethnies Minoritaires est sauvegardé. Création d’un club d’ambassadeurs du territoire ; Mise en place d’un programme de sensibilisation au patrimoine culturel et immatériel ; Mise en place d’un programme de valorisation du patrimoine culturel et immatériel Indicateurs de suivi : 3 pôles ressources sont construits et équipés ; 3 comités de gestion sont mis en place ; 5 agents de santé et 5 matrones de 5 villages différents renforcent leurs compétences ; 60 habitants de la région de Kédougou bénéficient d’une formation technique aux métiers de l’électricité et du solaire ; au moins 1000 habitants sont sensibilisés sur les règles d’hygiène et au paiement de l’eau ; au moins 15 personnes sont formées à la maintenance et à la gestion des ouvrages d’accès à l’eau. Indicateurs de résultats : Au moins 3 villages bénéficient de la mise en place d’infrastructures de qualité permettant un accès à l’eau potable et aux premiers soins ; Un accompagnement est réalisé pour la mise en place de comité de gestion ; 3000 personnes bénéficieront de ses infrastructures ; 10 000 personnes ont une connaissance des richesses et des enjeux liés aux patrimoines naturels et culturels de la région de Kédougou OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : R.3.1 L’Association des Minorités Ethniques est structurée et professionnalisée. Mise en place d’un comité d’accompagnement de l’Association des Minorités Ethniques ; Structuration et formation d’une équipe terrain ; Mise en place d’activités d’animation du territoire ; Mise en place de séminaires thématiques (maillage territorial, intégration du genre et implication de la jeunesse)R.3.2La gouvernance de l’itinéraire culturel est initiée. Mise en place d’un comité de réflexion stratégique de l’itinéraire culturel ; Réflexion à la mise en place d’une charte de territoire Indicateurs de suivi : L’Association des Minorités Ethniques est entourée d’un pool d’experts composé d’au moins 8 personnes ; Au moins 4 comités d’accompagnement sont organisés ; Une équipe de 3 professionnels est mis en place et est dotée de moyens ; les salariés et les membres de l’Association des Minorités Ethniques ont renforcé leurs compétences sur au moins 3 thématiques ; L’Association des Minorités Ethniques est visible auprès de 2000 personnes grâce à l’organisation d’évènements et la diffusion d’outils de communication ; 3 séminaires thématiques sont organisés ; Un comité de réflexion composé de 10 experts se réunit au moins 3 fois ; 1 accompagnement sur les modèles des retombées économiques est mis en place ;; 1 séminaire de réflexion est organisé.Indicateurs de résultats : L’association des Minorités Ethniques se dote d’un plan stratégique et d’un modèle économique pérenne ; Un document stratégique de gestion est rédigé |
2. OBJET DE L’EXPERTISE
L’évaluation a pour objectif central d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs posés lors de notre projet triennal (2022-2025) en vue de nous interroger sur nos pratiques pour la construction de la suite du projet. En se basant sur une vision critique des actions menées, l’évaluation devra permettre de se projeter à plus long terme et ainsi de donner une vision de ce que pourrait devenir le projet « Sur la piste du Caméléon ». Il s’agit en effet de voir plus profondément s’il convient de repenser certains fondamentaux, ses messages, sa structuration, ses modes d’action, sa pertinence après 3 années d’existence du projet.
Les conclusions de l’évaluation nous permettrons de redéfinir notre stratégie, de faire le point sur les attentes des partenaires et des populations et de dresser de nouvelles perspectives afin de donner davantage d’ambition à nos projets.
Cette évaluation externe devra donc :
- Fournir une appréciation générale du travail accompli, évaluer l’atteinte des objectifs posés lors du projet triennal 2022-2025, des dynamiques et processus mis en place, de manières qualitative et quantitative (indicateurs de performance à définir),
- Proposer un bilan des forces et faiblesses des objets d’évaluation identifiés,
- Revêtir une dimension prospective et permettre de donner une analyse et des pistes de (ré)-orientation / d’actions dans la perspective de présenter une nouvelle phase du projet à l’AFD et de guider éventuellement le développement de nouvelles composantes. Chaque recommandation stratégique devra être accompagnée d’une déclinaison en plans d’actions opérationnels.
3. Critères d’évaluation
L’évaluation produira une analyse et des recommandations pour chacun des sujets étudiés. Il conviendra d’analyser ces changements sous l’angle des 6 grands critères suivants :
La pertinence, qui examine le bien-fondé de l’action au regard des objectifs et enjeux déterminés au départ :
- Correspondance avec les besoins et les demandes des bénéficiaires
- Conformité avec les orientations générales de l’AFD
La cohérence apprécie les rapports entre les divers éléments constitutifs de l’action :
- Concordance des divers moyens et instruments mobilisés pour concourir à la réalisation des objectifs (cohérence interne) ;
- Concordance avec les actions entreprises par nos bailleurs et les politiques des partenaires (cohérence externe
L’efficacité, qui apprécie le degré de réalisation des objectifs de l’action ainsi que ses éventuels effets non attendus (effets positifs ou négatifs) :
- Résultats attendus et résultats effectifs de l’action
- Résultats imprévus (négatifs ou positifs, effets d’aubaine)
- Analyse des écarts constatés
L’efficience, qui étudie la relation entre les coûts et les avantages :
- Degré de réalisation des activités
- Taux d’exécution financière
- Qualité du suivi et de la gestion des imprévus
- Recherche des éléments de surcoût éventuel et de leurs causes
- Modalités de mobilisation des ressources financières, techniques, organisationnelles et humaines
- Comparaison des coûts avec des éléments de référence pertinents
- Analyse des modalités possibles qui auraient permis d’atteindre les mêmes résultats avec des moyens plus restreints ou des instruments différents
L’impact, qui juge les retombées de l’action à moyen et long terme en étudiant les effets de celle-ci dans un champ plus vaste. On mesure ici aussi bien les effets immédiats de l’action que les impacts à long terme et dans une vision élargie :
- Identification des catégories de la population ayant bénéficié (directement et/ou indirectement) de l’action et estimation du nombre de personnes concernées par catégorie
- Description quantitative de l’impact de l’action
- Description qualitative de l’impact de l’action (négatif, positif, attendu, imprévu)
La pérennité, qui examine si l’action a engendré une structure ou des pratiques capables de « vivre » et de se développer après la fin du programme :
- Viabilité financière et opérationnelle des mécanismes
- Prise en charge des activités par les responsables de l’action
- Maintien du partenariat en fonction de l’évolution de son contexte local
- Possibilité de reproduire ou de généraliser l’opération
4. METHODOLOGIE
Préparation
- Prise de connaissance des documents techniques et financiers et de la littérature disponible pour permettre une bonne compréhension du projet et du contexte de déroulement du projet. Les documents nécessaires à l’évaluation seront mis à disposition des évaluateurs-trices au démarrage du travail.
- Circonscription du champ d’évaluation, approbation du plan de travail d’évaluation avec l’équipe de pilotage de l’évaluation sur le terrain. Une brève note de cadrage à envoyer en amont de la réunion.
- Reconstitution de la logique d’intervention du programme pour fournir à l’évaluateur les données et informations nécessaires à la réalisation du travail d’analyse et de synthèse.
Visites de terrain & entretiens approfondis
En France et au Sénégal : entretiens avec les parties prenantes du projet :
- Les équipes projet en France (AMD, ESF, HSF et Tétraktys) et au Sénégal (AME)
- Les partenaires institutionnels du projet : Conseils Départementaux de Kédougou, de Salémata et de Saraya ; Communes et villages traversés par l’itinéraire (Communes des pôles ressources à privilégier – Fongolimbi, Bandafassi et Dar Salam);
- Les partenaires techniques du projet : Agence Régionale de Développement, Directions Régionales en lien avec les thématiques abordées, Centre Culturel Régional ; Village Communautaire de Bandafassi ; Université de la Huelva ; Compagnie des Inachevés ; le Musée Dauphinois ; Vision du Monde ; COS38
- Les bailleurs français (Agence française de développement, Ambassade de France, Département de l’Isère, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Fondations)
- Les bénéficiaires (lauréats des fonds d’appui, ambassadeurs du territoire, guides, habitants du territoire)
- Tout autre acteur qui vous semblera pertinent
Analyse et évaluation
Cette étape sera guidée par les données et informations tirées des sources publiées, par l’information interne émanant des parties prenantes, des données et avis recueillis lors des entretiens. L’évaluateur doit développer ses conclusions et recommandations en expliquant dans quelle mesure elles reposent sur les avis, des analyses ou des éléments objectifs et vérifiables.
Lorsque les avis recueillis lors des entretiens et des séances de travail en commun constituent la principale source d’information, l’évaluateur précisera le degré de consensus observé et les procédures appliquées pour vérifier ces avis.
Restitution
L’évaluateur organisera une réunion de restitution avec les parties prenantes du projet pour discuter de ses premières observations / analyses lors du comité d’orientation du programme.
Ainsi, le consultant proposera une méthodologie pour mener à bien l’expertise proposée, notamment :
- les principales phases de l’expertise avec les objectifs et la durée correspondants
- la participation des partenaires du projet au processus
- les méthodes et outils de collecte de données, y compris les enquêtes, questionnaires, observations sur le terrain, références aux registres administratifs et rapports de gestion, entretiens clés, etc.
- les méthodes et outils d’analyse de données.
Une attention particulière sera portée aux offres des évaluateurs-trices proposant une démarche d’évaluation participative et collective. De par le contexte dans lequel s’inscrit le projet et l’évaluation, les évaluateurs-trices devront de fait disposer d’une bonne connaissance des enjeux du territoire.
5. LIVRABLES & RESULTATS ATTENDUS
Un rapport d’évaluation en version initiale sera soumis par l’évaluateur, au plus tard le 10 octobre 2025 pour une présentation lors du comité d’orientation le 15 octobre à Kédougou. L’équipe projet procédera à une première lecture du rapport initial et apportera ses commentaires que l’évaluateur prendra en compte avant de rendre la version finale de son rapport maximum une semaine après retours/commentaires de l’équipe projet.
Le but du rapport :
- Présenter les conclusions de l’évaluateur
- Présenter les recommandations
Format du rapport :
Le rapport sera clair, synthétique et dénué d’ambiguïté. Il permettra de comprendre :
- la finalité et l’objet de l’évaluation,
- les modalités de conception et de conduite de l’évaluation,
- les éléments de preuve obtenus,
- les conclusions tirées de ces éléments de preuve,
- les recommandations et les enseignements découlant de ces conclusions.
La structure du rapport final sera composée de la manière suivante :
- Une page de couverture mentionnant le nom de l’évaluateur, le titre du rapport, les logos de l’AFD et des collectivités partenaires, du consortium technique, les dates de l’évaluation et l’indication que le rapport a été produit à la demande du consortium AMD-AME-ESF-HSF-Tétraktys et que l’exposé du rapport reflète strictement les opinions de l’évaluateur.
- Une table des matières
- Un résumé reprenant les principales conclusions et recommandations (5 pages max)
- Un rapport narratif
- Une conclusion
- Un tableau présentant les recommandations et des indications pour leur mise en œuvre
- Les annexes techniques : elles contiendront les détails techniques de l’évaluation, ainsi que les termes de référence, les modèles de questionnaires, checklist et canevas d’entretiens, éventuels tableaux ou graphiques, les références et autres sources d’informations, la liste des personnes rencontrées.
Le rapport sera rédigé en français et soumis en version informatique word.
Il sera d’abord soumis en version informatique et remise sous format papier strictement identique à la version finale au plus tard 1 semaine après les retours de l’équipe projet.
6. MONTANT DE LA PROPOSITION FINANCIERE
Le budget de l’évaluation est fixé à 20 000€ – vingt mille euros (TVA inclus) coûts directs et imprévus inclus. Ce budget inclut également les per diem et les déplacements pour les évaluateurs-trices.
Il est demandé aux évaluateurs-trices de faire dans leur offre une proposition budgétaire détaillée. Il est également demandé aux évaluateurs d’y préciser la répartition des jours de travail entre les différentes phases de l’évaluation (en lien avec leur proposition de méthodologie).
Les évaluateurs peuvent proposer des solutions de sous-traitance, mais ces montants devront rester dans l’enveloppe globale prévue pour l’évaluation. Ils peuvent également proposer une évaluation à plusieurs à condition que le rôle de chacun soit précisé.
7. Expertise recherchée
Profil souhaité pour les évaluateurs-trices chargé(e)s de l’étude :
- Références en évaluation externe
- Connaissance du secteur associatif sénégalais et français
- Connaissance du domaine de développement rural et des enjeux environnementaux
- Compétences en animation participative de groupe, techniques d’enquêtes, études de satisfaction, conduite d’entretiens individuels,
- Inventivité dans le dispositif et les méthodes d’évaluation, dans une dynamique collective et participative
- Qualité d’écoute, rigueur méthodologique, capacités de synthèse et d’analyse, ouverture d’esprit
- Capacité à faire émerger des recommandations stratégiques qui puissent se traduire dans des plans d’activités concrètes pour le prochain triennal
8. CALENDRIER
L’évaluation doit être réalisée en fin du triennal en cours et il est par ailleurs important que nous puissions intégrer des éléments de l’évaluation dans le prochain projet à déposer en novembre 2025.
Du fait de ces contraintes voici le calendrier prévisionnel proposé :
- Appel d’offres : du 31 juillet au 29 août
- Sélection : début septembre
- Mission d’évaluation en septembre / octobre 2025
- Soumission du rapport intermédiaire : 10 octobre 2025
- Présentation des résultats de la mission d’évaluation : 15, 16 ou 17 octobre 2025 (date à reconfirmer)
- Remise du rapport final : 27 octobre 2025
9. COORDONNEES
Cet appel d’offre est destiné à identifier un/des consultant(e)(s) pour la réalisation de l’évaluation externe du projet « Sur la piste du Caméléon » porté conjointement par AMD, AME, ESF, HSF et Tétraktys.
Si vous souhaitez manifester votre intérêt, merci de bien vouloir envoyer : votre CV, votre proposition et un budget détaillé ainsi que la déclaration d’intégrité complétée et signée (annexe 1)
Ces documents sont à transmettre par courrier électronique au plus tard pour le vendredi 29 août à l’attention simultanée de :
- Bacari CAMARA, responsable du programme | camaraspc.ame@hotmail.com
- Mathilde POPINEAU, cheffe de projets internationaux |mathilde.popineau@tetraktys-ong.org
- Sarah MAUPIN, chargée d’appui au programme | senegal@tetraktys-ong.org
Vous souhaitez déposer un appel d’offre ?
Déposez vos appels d'offres pour vos recherches de prestations visant à renforcer votre organisation, faciliter vos projets...
Déjà inscrit ?
L’ABC des prestataires
Plus de 50 prestataires référencés dans notre base !
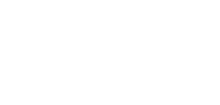
Tout chaud
Nous ne sommes pas des cibles : stop à l’impunité
3 questions à Sophie Lehideux, Membre du comité de décision FRIO
Appel à une transformation de l’action humanitaire