Evaluation externe finale de projet « MAHARINA – Assistance humanitaire dans les communes de Sandravinany & Fenoambany » à Madagascar
1.PRESENTATION DU PROJET
1.1 Informations générales sur le contexte d’intervention
Madagascar est fréquemment touchée par des catastrophes naturelles, cyclones, inondations et pics de sécheresse, se classant parmi les dix pays les plus vulnérables aux catastrophes dans le monde, et le pays d’Afrique le plus exposé aux cyclones. En moyenne, selon les estimations, les pertes directes dues aux vents, aux inondations et aux marées de tempête associées aux cyclones tropicaux s’élèvent à 87 millions de dollars par an, représentant 86 % des pertes totales dues aux catastrophes naturelles (cyclones, inondations, séismes) dans le pays (Banque Mondiale & GFDRR, 2016).
Cette exposition récurrente aux aléas climatiques a des conséquences majeures sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Madagascar figure au 10e rang mondial et au 7e en Afrique pour la malnutrition chronique, avec près des deux tiers des enfants malgaches souffrant de pauvreté multidimensionnelle (Plan National d’Actions Multisectorielles pour la Nutrition Madagascar 2022- 2026). Entre septembre et décembre 2024, environ 1,63 million de personnes ont été confrontées à une insécurité alimentaire aiguë élevée (Phase 3 de l’IPC ou plus), nécessitant une intervention humanitaire urgente (Rapport IPC, janvier 2025).
Les communautés du Grand Sud-Est sont particulièrement impactées par les cyclones et sont confrontées à une insécurité alimentaire accrue, une situation qui s’est intensifiée depuis 2022, en raison des cyclones tropicaux successifs ayant fortement perturbé les moyens de subsistance locaux, exacerbé les maladies infantiles et limité l’accès aux services sociaux de base (OCHA, Madagascar, Humanitarian Response Dashboard, janvier 2023 – mai 2024). Dans le District de Vangaindrano, situé dans la région Atsimo Atsinanana, entre juin et novembre 2024, plus de 237 000 personnes étaient en situation de stress alimentaire (IPC 2), dont plus de 64 000 en situation de crise (IPC 3). Cette situation s’aggrave généralement pendant la période de soudure de janvier à avril, coïncidant avec la saison cyclonique, exposant la zone à une situation d’IPC 3.
Les communes d’intervention du projet — Sandravinany et Fenoambany — sont confrontées à une pauvreté structurelle marquée, faisant parties des 43 % des communes de la région Atsimo Atsinanana classées comme « très pauvres » (Bulletin SISAV, 2022). Ces communes regroupent des ménages dont les principales sources de subsistance, l’agriculture et la pêche, sont gravement affectées par divers facteurs climatiques. Les cyclones ont un fort impact sur les moyens de subsistance des ménages, qui, confrontés également à une pauvreté structurelle, à des problèmes de gouvernance et à la sécheresse, entre autres, ne parviennent plus à se rétablir avant la saison cyclonique suivante. Malgré ce contexte, le district de Vangaindrano reste peu couvert par les acteurs humanitaires. La cartographie des interventions du cluster Sécurité alimentaire et moyens de subsistance de 2024 révèle une concentration des projets dans d’autres régions comme le Sud (Androy, Anosy) ou le Sud-Est central (Fitovinany, Vatovavy, Tolagnaro).
1.2 Présentation du partenaire
Sampan’Asa momba ny Fampandrosoana FJKM (SAF/FJKM) est le Département pour le Développement de l’Église de Jésus Christ à Madagascar, créé en 1974. Il s’agit d’une organisation non gouvernementale malgache qui intervient dans les domaines de l’humanitaire et du développement social et économique à Madagascar. Sa mission est d’œuvrer pour la dignité de l’homme, et sa vision est de considérer l’homme, à la fois acteur et finalité du développement, comme étant digne de l’image de Dieu, vivant dans une communauté responsable et active. SAF/FJKM dispose d’un siège social à Antananarivo et de 59 antennes réparties sur 21 régions du pays, incluant 35 dispensaires et 24 unités de développement. L’organisation mobilise également plus de 10 000 volontaires, qui jouent un rôle clé dans l’implémentation des projets. SAF/FJKM intervient dans cinq domaines : la gestion des risques et des catastrophes, la santé, la sécurité alimentaire et la nutrition, l’environnement et les changements climatiques ainsi que le secteur de l’eau, assainissement et hygiène.
1.3 Description du projet à évaluer
Le projet MAHARINA (un mot malagasy qui signifie “qui peut se relever”) a été mis en œuvre du 1er décembre 2024 au 30 juin 2025 pour soutenir les communautés vulnérables durant la période de soudure et le passage de cyclones dans les communes de Fenoambany et Sandravinany. Ce projet visait à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la préparation face aux risques de catastrophes. Il s’agit du second partenariat entre le Secours Catholique – Caritas France (SCCF) et SAF/FJKM, dans la continuité du projet CARD mené en 2024 dans les communes de Sandravinany et Amparihy Est.
La stratégie pour pouvoir répondre aux besoins identifiés prévoyait la prise en charge de 180 femmes enceintes ou allaitantes et de 250 enfants de moins de 5 ans en situation de malnutrition aigüe modérée (MAM) à travers des activités de dépistage, de distribution de compléments alimentaires pendant 49 jours et de suivi nutritionnel. Ces distributions ont été organisées dans les neuf Fokontany du projet, avec un site par localité. Les enfants identifiés en situation de malnutrition aiguë sévère (MAS) devaient être référencés systématiquement vers les Centres de Santé de Base ou d’autres organisations pour une prise en charge appropriée.
D’autre part, 500 ménages vulnérables ont bénéficié d’une assistance sous la forme d’Argent Contre Travail (ACT) ou de Cash Inconditionnel (pour les ménages avec incapacité physique) pendant 3 mois (février-avril) durant la période de soudure en 2025. Ces ménages ont travaillé à la réhabilitation/construction d’infrastructures communautaires identifiées de façon participative (pistes noires, curage de puits, canalisation etc.). Cette activité permettait ainsi de répondre à leurs besoins essentiels pendant les mois les plus compliqués (saison cyclonique et soudure) tout en améliorant des infrastructures communautaires accessibles à tous.
Le projet prévoyait également de renforcer la résilience des communautés face aux défis environnementaux, à travers la formation en Smart Agriculture de 150 agriculteurs de Fenoambany et 50 agriculteurs de Sandravinany. Par exemple, l’agroforesterie et la rizipisciculture sont des techniques qui peuvent améliorer la productivité tout en préservant l’environnement et en s’adaptant au changement climatique.
Enfin, dans la continuité du projet CARD mis en œuvre en 2024 par SAF/FJKM avec le soutien du SCCF, les 5 Equipes Locales de Secours (ELS) et les 2 Comités Communautaires de Gestion des Risques de Catastrophes (CCGRC) ont été formés et dotés de kits d’urgence.
1.4 Objectifs du projet
Objectif global : Les communautés vulnérables des communes de Sandravinany et Fenoambany (District de Vangaindrano, Région Atsimo Andrefana) parviennent à satisfaire leurs besoins essentiels et à faire face à l’insécurité alimentaire et aux impacts des cyclones.
Objectif spécifique 1 : Contribuer à la sortie de l’état d’insécurité alimentaire des ménages ciblés confrontés aux impacts de la période de soudure et de la saison cyclonique.
Objectif spécifique 2 : Soutenir les moyens de subsistance des ménages pour favoriser la résilience des communautés face aux cyclones tropicaux.
1.5 Résultats attendus du projet
Résultat 1 : La situation nutritionnelle de 180 femmes enceintes, allaitantes et de 250 enfants est améliorée par rapport au début et au pic de la période de soudure.
Résultat 2 : L’assistance humanitaire fournie au travers de l’Argent Contre Travail permet à 500 ménages vulnérables de subvenir à leurs besoins essentiels.
Résultat 3 : Des activités de résilience pour faire face aux aléas climatiques et l’insécurité alimentaire sont initiées
1.6 Groupes cibles et bénéficiaires du projet
Les bénéficiaires du projet MAHARINA sont des habitants des communes de Sandravinany et de Fenoambany. Concernant le volet nutrition, l’identification des bénéficiaires a été réalisée au travers du dépistage de la malnutrition par des agents communautaires des Centres de Santé de Base et des assistants nutritionnels. Concernant l’ACT, le ciblage a été réalisé de manière participative, en s’appuyant sur des critères économiques (absence de source de revenu, un repas par jour ou moins, absence de bétail…) et des critères sociaux (présence de personnes en situation de handicap, personnages âgées, orphelins ou enfants vulnérables, personnes atteintes de maladies chroniques, femmes chefs de ménage avec enfants, ménages dirigés par une veuve ou un veuf…). Enfin, les participants aux formations agricoles ont été sélectionnés par un comité de ciblage communautaire, selon des critères économiques.
Après révision en mai 2025, le projet cherchait à atteindre 3130 bénéficiaires directs, répartis comme suit :
Nutrition
- 180 femmes enceintes ou allaitantes ;
- 250 enfants en situation de MAM ;
Argent contre travail
- 500 ménages soutenus, soit 2500 personnes ;
Formation en SMART AGRI
- 200 agriculteurs.
Le projet visait également 18 483 bénéficiaires indirects pour les deux communes (3 500 personnes à raison de 5 personnes par ménage et 14 983 personnes touchés indirectement par la participation des bénéficiaires à l’économie locale).
2.OBJECTIFS DE L’EVALUATION
2.1 Objectif général
L’objectif de cette évaluation finale externe est d’analyser l’impact du projet MAHARINA. Cette évaluation doit mesurer les changements réalisés en matière de nutrition, de sécurité alimentaire, de résilience et de préparation aux catastrophes, ainsi que l’efficacité des approches mises en place. L’évaluation fournira également des recommandations pour garantir la durabilité des résultats obtenus par le projet.
2.2 Objectifs spécifiques
- Déterminer dans quelle mesure le projet a réussi à atteindre les résultats et les objectifs établis tels qu’énoncés dans la proposition de projet et le cadre logique ;
- Identifier les bonnes pratiques et les leçons apprises, en particulier en matière de redevabilité vis-à-vis des populations, de transparence et d’efficacité des processus de mise en œuvre et de suivi budgétaire ;
- Évaluer la pertinence de la stratégie de mise en œuvre, des méthodologies et des procédures associées ainsi que des dispositifs de coordination entre les équipes terrain et siège, les autorités locales et les autres acteurs humanitaires.
3.CRITERES DE L’EVALUATION
3.1 Pertinence, cohérence, stratégie d’intervention du projet
- La sélection des zones ciblées était-elle appropriée afin d’atteindre les personnes les plus vulnérables en besoin d’assistance ?
- La conception et la mise en œuvre de l’intervention étaient-elles pertinentes et de qualité au regard des problèmes et/ou besoins identifiés dans la zone du projet ?
- Les mécanismes de ciblage ont-ils été inclusifs et ont-ils permis d’atteindre les populations les plus vulnérables ? Comment a-t-on identifié les groupes vulnérables ?
- Le ciblage des bénéficiaires en situation de MAM était-il aligné avec les recommandations des autorités sanitaires locales et cohérent avec les interventions des autres organisations actives dans la zone ?
- Existe-il une cohérence interne ? (Synergies et interdépendances entre les interventions menées par SAF/FJKM, ainsi que la cohérence entre l’intervention et les normes et standards auxquels l’organisation adhère).
- Existe-il une cohérence externe ? (Cohérence entre l’intervention considérée et celles menées par d’autres acteurs dans le même contexte).
- La coordination avec les services de santé, les partenaires du secteur nutrition et les autres organisations intervenant dans la zone a-t-elle été effective et adaptée ?
- Les besoins non couverts ont-ils été redirigés vers des structures de santé appropriées ou signalés à des organisations disposant du mandat et de l’expertise nécessaires pour y répondre ? Le référencement des enfants atteints de malnutrition aiguë sévère (MAS) vers des structures adaptées a-t-il été systématique et efficace ?
- Les risques et contraintes sont-ils régulièrement identifiés, analysés et les plans adaptés pour que l’action proposée soit réaliste et sûre pour les communautés ?
3.2 Efficacité et efficience du projet
- Les objectifs ont-ils été atteints ? Les indicateurs prévus permettent-ils de mesurer l’accomplissement de l’objectif spécifique ?
- La mise en œuvre des activités permet-elle de répondre aux priorités du projet et des populations ?
- Le chronogramme est-il conçu en fonction des moments les plus propices aux activités, en tenant compte de facteurs tels que les facteurs climatiques ou saisonniers (période de soudure, saison cyclonique), et a-t-il été respecté ?
- Les standards techniques pertinents et les bonnes pratiques employées dans les secteurs Nutrition, Sécurité Alimentaire et Préparation aux Risques de Catastrophes ont-ils été utilisés ?
- Les activités nutritionnelles mises en œuvre ont-elles été conformes aux normes nationales, protocoles régionaux et directives du cluster Nutrition ?
- Dans quelle mesure le suivi et l’évaluation du projet contribue-t-il (ou non) à l’efficacité de la stratégie (outils, méthodes et mécanismes de suivi et évaluation) ?
- Les ressources humaines et financières allouées au projet ont-elles été suffisantes et appropriées ?
- Le projet a-t-il été conçu et les processus mis en œuvre pour garantir l’utilisation efficiente des ressources, en trouvant un équilibre entre la qualité, le coût et le respect des délais de chaque phase de l’intervention ?
- Le budget alloué à chaque volet (nutrition, ACT, formation agricole, préparation aux catastrophes) a-t-il été suivi et utilisé conformément aux prévisions ? Des ajustements ont-ils été effectués, et pourquoi ? Le suivi budgétaire a-t-il permis d’identifier ces besoins de réaffectation à temps ?
- Le dispositif de suivi a-t-il permis une estimation claire, cohérente et bien documentée du nombre de bénéficiaires directs et indirects, en distinguant de manière appropriée les types d’unités (individus, ménages, etc.) selon les activités menées ?
- Les supports et accompagnements fournis par le SCCF ont-ils été suffisants et bien adaptés aux besoins du partenaire ? Quelles améliorations pourraient être mises en place ?
3.3 Impact et durabilité du projet
- Le projet a-t-il contribué à renforcer la résilience des communautés d’intervention face aux aléas climatiques ?
- Le soutien apporté aux 500 ménages vulnérables sous forme d’Argent Contre Travail a-t-il permis de répondre efficacement à leurs besoins essentiels pendant la période de soudure, tout en améliorant les infrastructures communautaires ?
- Les connaissances, attitudes et pratiques des ménages en matière de nutrition infantile ont-elles évolué grâce aux activités du projet et à l’accompagnement mis en place ?
- Quels sont les effets imprévus du projet, positifs ou négatifs, sur les moyens de subsistance des ménages et leur préparation face aux risques de catastrophes (cyclones, inondations) ?
- Les résultats du programme auront-ils une chance de perdurer après l’arrêt du financement du SCCF ?
- Quels sont les principaux facteurs qui influencent la réalisation ou la non-réalisation de la durabilité du projet ?
- Une stratégie de transition ou de sortie a-t-elle été prévue dès les premières phases du projet afin de garantir des effets positifs à plus long terme et de réduire les risques de dépendance ?
- L’intervention a-t-elle contribué au développement du leadership local et des initiatives locales en ce qui concerne leurs capacités de premiers intervenants dans l’éventualité des prochaines crises, tout en prenant des mesures pour garantir que les groupes marginalisés et défavorisés soient représentés de façon adéquate ?
3.4 Redevabilité
- Des informations ont-elles été fournies aux communautés et personnes affectées par la crise à propos de l’organisation SAF/FJKM, des principes qu’elle respecte, du comportement qu’elle demande à son personnel, des projets qu’elle met en œuvre et de l’aide qu’elle cherche à apporter ?
- Ces informations ont-elles été fournies dans des langues, formats et médias facilement compréhensibles, respectueux et adaptés aux différents membres de la communauté, en particulier les groupes vulnérables et marginalisés ?
- Les communautés sont-elles satisfaites de la communication sur le projet ?
- Les critères de sélection des bénéficiaires étaient-ils bien compris par les communautés ?
- Le caractère inclusif de la représentation a-t-il été assuré, en impliquant la participation et l’engagement des communautés à toutes les phases de l’intervention ?
- Donne-t-on à tous les groupes au sein de la population affectée, et notamment aux personnes marginalisées et vulnérables (femmes, personnes âgées…), une possibilité équitable de faire valoir leurs avis ?
- Les communautés et les personnes affectées par la crise ont-elles été encouragées et aidées à faire part de leur niveau de satisfaction par rapport à la qualité et à l’efficacité de l’aide reçue, en accordant une attention particulière au genre, à l’âge et à la diversité des personnes qui donnent leur avis ?
- Les communautés et les personnes affectées par la crise ont-elles été sensibilisées sur la mise en œuvre et le suivi des processus de traitement des plaintes ? A-t-on communiqué sur la manière dont le mécanisme était accessible et sur le périmètre des problématiques qu’il pouvait traiter ?
- Les plaintes ont-elles été gérées en temps voulu, d’une façon juste et adaptée qui priorise la sécurité du plaignant et des personnes affectées à toutes les phases ?
- Le personnel signe-t-il un code de conduite ou un document similaire ? Si tel est le cas, reçoit-il des explications à ce sujet ainsi que sur les autres politiques pertinentes lui permettant de bien les comprendre ?
4.METHODOLOGIE DE L’EVALUATION
L’évaluation finale du projet adoptera une approche participative, visant à impliquer activement toutes les parties prenantes, y compris les communautés, les bénéficiaires des deux communes du projet, le personnel de SAF/FJKM et d’autres acteurs pertinents. Une telle méthodologie est attendue pour faciliter une analyse approfondie des résultats et des perceptions des acteurs impliqués. À cet égard, des techniques de diagnostic participatif (observation directe, focus groups, entretiens individuels, …) seront privilégiées pour recueillir des données qualitatives sur l’impact du projet et obtenir des retours sur sa mise en œuvre. Par ailleurs, une analyse des documents et données existantes devra compléter les informations collectées sur le terrain.
L’évaluation devra également porter une attention particulière au volet nutrition du projet, à la coordination avec les autres acteurs présents dans la zone d’intervention ainsi qu’entre l’équipe terrain et le siège, à la transparence et l’efficacité des mécanismes de suivi budgétaire et de gestion de projet.
Des recommandations pratiques devront être formulées dans le but d’améliorer la durabilité et l’efficacité du projet et de renforcer la stratégie d’accompagnement du SC-CF auprès du partenaire SAF/FJKM.
La méthodologie de réalisation de l’évaluation sera explicitée par la/le.s consultant.e.s dans son/leur offre. La qualité de la méthodologie proposée constituera un critère déterminant dans le choix final des consultants.
5.ASPECTS TECHNIQUES DE L’EVALUATION
5.1 Calendrier de l’évaluation
- Publication de l’offre : 25 juin 2025
- Réception des propositions : jusqu’au 20 juillet 2025
- Processus de sélection : Août 2025
- Début de l’évaluation : mi-septembre 2025
- Partage du rapport provisoire : mi-octobre 2025
- Présentation/restitution des résultats de l’évaluation par visio-conférence : fin octobre 2025
- Partage du rapport définitif : novembre 2025
5.2 Budget disponible
Le budget maximum disponible pour cette évaluation est de 10 000 euros. Cette enveloppe comprend les honoraires ainsi que les frais de mission.
5.3 Présentation du rapport et livrables attendus
Il sera demandé à l’équipe d’évaluation de fournir :
- Un rapport provisoire en français : ce rapport, élaboré après la phase de collecte des données, présente les conclusions initiales de l’évaluation. Il est destiné à être soumis au SCCF et à SAF/FJKM pour recueillir leurs observations et commentaires (en version électronique sous format Word).
- Un rapport définitif en français (en version électronique sous format Word, entre 15-20 pages maximum, sans compter les annexes). Ce dernier sera accompagné d’un résumé exécutif de 3-4 pages maximum incluant l’essentiel des informations du rapport. Le rapport intégrera les remarques émises lors de la réunion de restitution. Il sera la propriété du Secours Catholique – Caritas France et de SAF/FJKM qui pourront le diffuser si nécessaire.
Le rapport d’évaluation devra contenir l’index suivant :
- Résumé exécutif : (3-4 pages au maximum) : y compris les principales conclusions et recommandations.
- Introduction :
- Antécédents et objectif de l’évaluation.
- Questions initiales et critères : définition.
- Description résumée de l’intervention évaluée, résumé des antécédents, organisation et gestion, acteurs impliqués et contexte dans lequel se déroule l’
- Méthodologie utilisée lors de l’évaluation.
- Méthodologie et techniques appliquées.
- Prérequis et limites de l’étude réalisée.
- Analyse de l’information collectée et réponses aux questions clés des critères d’évaluation.
- Conclusions de l’évaluation, vis-à-vis des critères d’évaluation établis.
- Leçons apprises des conclusions générales illustrant de bonnes pratiques et pouvant rétro-alimenter les actions de l’intervention ou servir pour des futures interventions.
- Recommandations classifiées selon le critère choisi par l’équipe d’évaluation. Si possible, mentionner les acteurs et les actrices auxquels s’adresse la recommandation.
- Annexes :
- Les TdR,
- Le plan de travail, la composition et la description de la mission ;
- Méthodologie proposée, techniques et sources utilisées pour collecter l’information ;
- Révision documentaire : liste des sources secondaires utilisées ;
- Entretiens : liste d’informateurs, plans des entretiens, transcriptions et notes ;
- Enquêtes : modèles, données brutes collectées et analyse statistique ;
- Ateliers participatifs : rapport et produits ;
- Réactions et commentaires de la part de différents acteurs sur la version préliminaire du rapport si ces derniers sont pertinents, notamment en cas de désaccord n’ayant pas été reflété dans le rapport.
6.REMISE DES OFFRES
6.1 Profil recherché
L’étude sera menée par un cabinet ou un(e) consultant(e) justifiant :
- Une expérience d’au moins 5 ans dans l’évaluation de projets humanitaires ;
- Une expérience obligatoire à Madagascar, accompagnée d’une bonne connaissance du contexte local et d’une capacité d’accès sur le terrain ;
- Une expérience dans l’évaluation de projets axés sur la nutrition, la sécurité alimentaire, la préparation aux risques de catastrophes, les moyens d’existence ou l’agriculture serait un atout ;
- D’amples connaissances de méthodes et techniques de recherche tant quantitatives que qualitatives ;
- Une connaissance de la Norme Humanitaire Fondamentale (Core Humanitarian Standard) ;
- Une maîtrise des techniques participatives et autres approches de collecte et d’analyse des données relatives ;
- Une excellente maitrise du français, du malgache et compréhension du dialecte du grand Sud-Est (Antesaka, Antemoro, Antefasy)
- Une capacité à mettre en avant des dynamiques de groupe, à organiser et à proposer des ateliers de débat et à préparer des documents de capitalisation.
6.2 Présentation de l’offre technique et de l’offre financière
Les propositions techniques et financières devront respecter les caractéristiques suivantes :
- Une synthèse de direction de 2 pages au maximum, mettant en évidence les points forts de la proposition et en quoi elle répond aux attentes du SCCF et de son partenaire;
- Offre technique : indiquant la compréhension des termes de références, une proposition de la méthodologie d’évaluation choisie, les références sur les prestations similaires (réalisés par le ou le consultant ou l’équipe proposés) avec des preuves à l’appui (un exemple d’une évaluation déjà réalisée, des attestations de prestation de services, maximum 3 références), un curriculum vitae détaillé et actualisé du consultant ou des membres composant l’équipe de consultance (+ organisation de l’équipe et du rôle de chacun), la matrice d’évaluation et un calendrier provisoire détaillé renseignant sur la durée de l’étude ;
- Offre financière : L’offre économique doit contenir tous les détails possibles, incluant les taxes et impôts avec le budget global en euros (hors taxe et toutes taxes comprises si TVA applicable) et les prix détaillés (honoraires, déplacements…). Sachant que les frais autres que les honoraires seront remboursés sur les frais réels engagés sur présentation d’une facture avec les justificatifs correspondants.
6.3 Modalités de candidature
Seuls les consultants indépendants dument enregistrés ou les salariés d’une société de conseil peuvent répondre. Une couverture assurance santé, évacuation médicale, accident et responsabilité civile sera exigée. Il n’y aura qu’un seul contrat, dans le cas ou plusieurs consultants indépendants répondraient ensemble il faudra qu’un mandataire soit désigné dans la proposition.
Les offres techniques et financières sont à envoyer par e-mail en précisant l’objet « EVAL/MAHARINA » avant le 20 juillet 2025 minuit (heure française, UTC+02) à Léa Gareton, Chargée de projets Afrique & Océan Indien (lea.gareton@secours-catholique.org) et à l’adresse : dept.personnelappuiexterne@secours-catholique.org.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus.
Vous souhaitez déposer un appel d’offre ?
Déposez vos appels d'offres pour vos recherches de prestations visant à renforcer votre organisation, faciliter vos projets...
Déjà inscrit ?
L’ABC des prestataires
Plus de 50 prestataires référencés dans notre base !
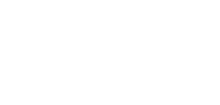
Tout chaud
Nous ne sommes pas des cibles : stop à l’impunité
3 questions à Sophie Lehideux, Membre du comité de décision FRIO
Appel à une transformation de l’action humanitaire