Recrutement d’un·e consultant·e pour l’évaluation intermédiaire d’un programme multi-pays
| Intitulé du projet | « FORSS – FORmer, Suivre, Soutenir : mobilisation communautaire pour lutter contre le VIH/sida en région MENA » |
| Porteur de projet | Solidarité Sida |
| Partenaire(s) de mise en oeuvre | ITPC-MENA – International Treatment Preparedness Coalition (Maroc) AGD – Association des Gestionnaires pour le Développement (Mauritanie) ATL MST SIDA – Association tunisienne de lutte contre les MST et le SIDA (Tunisie) Marsa – (Liban) RDR-Maroc – Association nationale de réduction des risques des drogues (Maroc) |
| Pays de mise en œuvre | Phase 2 – 2023-2026 (à évaluer) : France, Liban, Maroc, Mauritanie, Tunisie Phase 1 – 2018-2022 : France, Liban, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Egypte |
| Date de démarrage du projet | 1er mai 2023 |
| Durée | 36 mois |
La propagation du VIH/sida en région Afrique du Nord Moyen-Orient (MENA) est critique, particulièrement chez les populations les plus vulnérables et marginalisées. L’accès aux services de dépistage et de soins y est limité et les politiques nationales encore trop insuffisantes pour juguler l’épidémie. La région manque d’un système de veille communautaire pour mieux comprendre les dysfonctionnements existants et les besoins des bénéficiaires des services, afin d’y répondre efficacement. C’est en réponse à ce contexte que depuis 2018, Solidarité Sida, ITPC-MENA et leurs partenaires associatifs mettent en œuvre le Programme « FORSS – FORmer, Suivre, Soutenir : mobilisation communautaire pour lutter contre le VIH en région MENA », visant le déploiement d’observatoires communautaires dans 5 pays afin de collecter des informations fiables et valides sur l’état et la qualité des services et d’alerter sur les barrières et obstacles d’accès aux soins pour les Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) et populations clés (PC). Bien que fortement impactés et ralentis par la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, les 4 observatoires fonctionnels lors de la phase 1 (Egypte, Mauritanie, Tunisie, Maroc) révélaient, entre autres, de faibles connaissances de l’épidémie, des moyens de prévention et des traitements ARV, un manque d’éducation thérapeutique (particulièrement en Mauritanie), une difficulté d’accès géographique aux centres de soins (dans les 4 pays), ou encore des phénomènes de stigmatisations et discriminations (perçues ou vécues).
Pour renforcer durablement la riposte au VIH dans cette région où seules 43% des PVVIH connaissant leur statut sérologique avec un faible accès aux traitements antirétroviraux, Solidarité Sida, ITPC-MENA et leurs partenaires ont proposé une 2nde Phase pour intensifier et élargir le travail des observatoires communautaires. Cette Phase 2 est déployée au Maroc, au Liban, en Mauritanie et en Tunisie, et intègre deux nouveaux partenaires (Marsa au Liban et ATL MST SIDA en Tunisie). En plus des acteur·rices communautaires, elle vise une cible supplémentaire, les ressources humaines en santé (RHS), avec pour objectif de contribuer à l’accélération de la riposte VIH dans la région MENA en renforçant l’interaction entre les systèmes de santé communautaire et formel pour une prise en charge de qualité des PVVIH et groupes de populations clés. Afin d’être en capacité d’identifier les barrières spécifiques à chaque sous-groupe, les questionnaires ont été conçus pour collecter des données désagrégées par genre. Cette démarche permet de mettre en avant des données spécifiques afin de construire une approche genre cohérente et de nourrir une stratégie de plaidoyer à la fois sur le plan national et régional.
Cette 2nde Phase repose sur quatre piliers pour assurer l’atteinte de cet objectif et la pérennisation des mécanismes de veille communautaire :
- Le renforcement des connaissances, attitudes et pratiques des acteur·rice·s communautaires et du système de santé formel sur l’impact de la qualité de la prise en charge, sur l’accès aux soins et la reconnaissance des droits des PVVIH et PC.
- La collecte, l’analyse et la diffusion de données sur les barrières à l’accès aux services et produits de santé existants au niveau local (dans les villes ciblées par la collecte), national et régional, en intégrant de nouvelles cibles et bénéficiaires, tout en prenant en compte les résultats issus de la 1ère Phase, en matière de mise en oeuvre et de résultats.
- Le déploiement de stratégies et d’actions de plaidoyer innovantes pour influencer les politiques de lutte contre le VIH/sida et leurs modalités de mise en oeuvre au niveau local, national et régional, en capitalisant sur les résultats des actions déployées dans la Phase 1.
- La pérennisation des mécanismes de veille communautaire au-delà du projet, en garantissant une capitalisation continue de leur fonctionnement et leur reconnaissance par l’ensemble des parties prenantes au niveau local, national et régional.
Présentation de Solidarité Sida et des associations partenaires
SOLIDARITÉ SIDA – France
Depuis 1992, l’histoire de Solidarité Sida est celle d’un engagement collectif et générationnel fondé sur l’envie d’agir. Elle démontre avec force que, contrairement aux idées reçues, les jeunes sont prêts à s’engager. Par ses initiatives, l’association leur offre un terrain d’action citoyen ou répond à leurs préoccupations en termes de santé et/ou de sexualité. Ils sont plus de 3000 bénévoles à faire vivre la chaîne de solidarité sur laquelle s’appuie la démarche de Solidarité Sida.
Les missions : Aider, Prévenir, Défendre et mobiliser
Aider : De Paris à Bombay, de Lomé à Dakar, Solidarité Sida agit pour accompagner les plus vulnérables et réduire les inégalités dans l’accès aux traitements et aux soins. Prévenir : On meurt toujours du sida en France et un jeune sur 3 n’utilise pas systématiquement de préservatif. Ici ou ailleurs, la nécessité d’innover pour être écouté se fait grande. Défendre et mobiliser : Combattre le scandale de l’inégalité de l’accès aux traitements, c’est une question de prise de conscience individuelle et de volonté politique. Solidarité Sida mobilise les jeunes et interpelle gouvernements et médias pour un accès universel aux traitements à l’occasion de campagnes spécifiques.
ITPC-MENA – Maroc
ITPC-MENA est un réseau régional constitué d’activistes, de personnes vivant avec le VIH et leurs défenseurs œuvrant ensemble pour assurer l’accès universel aux services de traitement, de prévention et de santé pour les PVVIH et les populations clés. L’association héberge la Plateforme Régionale MENA, l’une des six plateformes régionales soutenues par le Fonds mondial et issues de la société civile et des communautés. Ces plateformes travaillent à l’élaboration, la mise en œuvre et la surveillance des programmes du Fonds mondial. Ainsi, ITPC assure la mise à disposition d’un large réseau de partenaires et le partage d’informations ; le renforcement des capacités concernant les processus du Fonds mondial ; la constitution et le traitement des données et informations relatives au FM et à la société civile (évaluation des besoins, cartographie des ONG régionales, analyses contextuelles, etc.) ; l’identification des besoins en assistance technique de la société civile et la mise en relation avec les prestataires d’assistance technique ; la mise à disposition de documents d’information, de bonnes pratiques, des directives relatives au FM traduites dans les différentes langues de la région MENA.
AGD – Mauritanie
AGD est une association créée le 22 juillet 2003 à Nouakchott qui vient répondre aux besoins de plus en plus accrus des populations en éducation pour le changement de comportement.
L’association s’est donné comme missions de promouvoir l’éducation aux droits humains (éducation à la citoyenneté et à la bonne gouvernance), la santé et les droits sexuels et reproductifs, y compris la lutte contre le VIH/sida, de même que l’entreprenariat et l’engagement des jeunes.
ATL – Tunisie
Créée en 1990, l’ATL MST SIDA est la 1ère association de lutte contre le sida en Tunisie sous-récipiendaire de la subvention nationale du Fonds mondial, contribuant à la riposte du VIH en Tunisie et à la réduction de l’impact de la maladie à tous les niveaux et participant activement aux efforts de la société civile pour lutter contre cette épidémie.
MARSA – Liban
Marsa, association libanaise, a créé à Beyrouth un centre de santé sexuelle et fournit grâce à une équipe multidisciplinaire des services de santé sexuelle et reproductifs dans un environnement sûr, accueillant, accessible et convivial exempt de jugement et de préjugés mettant un accent particulier sur les femmes, les groupes vulnérables et les populations économiquement défavorisées.
RDR-MAROC – Maroc
Créée en 2008, l’association RdR-Maroc a implanté ses programmes de réduction des risques dans plusieurs sites prioritaires (notamment Nador, Rabat, Al Hoceima et Oujda) en appui à la mise en place de la stratégie nationale. Elle assure également la gestion et l’animation de 8 centres d’addictologie sur tout le territoire. Elle a été mobilisatrice de la société civile et des instances nationales.
OBJECTIFS DU PROJET ET RÉSULTATS ATTENDUS
Objectif général : Le projet vise à accélérer la riposte VIH dans la région MENA et améliorer la prise en charge de qualité des PVVIH et groupes de populations clés, en renforçant l’interaction entre les systèmes de santé communautaire et formel.
Objectifs spécifiques et résultats attendus :
OS1 – Renforcer les connaissances, attitudes et pratiques des acteur·rice·s communautaires et du système de santé formel pour une prise en charge de qualité des PVVIH et groupes de populations clés.
R1 – Un socle de formation commun est construit, alimenté par les recommandations des observatoires communautaires et adapté aux contextes nationaux.
R2 – Les acteur·rice·s communautaires et du système de santé formel s’approprient les démarches et outils via un cycle de formation complet.
OS2 – Disposer de données locales, nationales et régionales sur les expériences croisées (patient·e·s/agents de santé) relatives à l’accessibilité, la disponibilité, la qualité, l’utilisation et l’acceptabilité des services liés au VIH/sida.
R1 – Les mécanismes de veille communautaire sont améliorés et élargis pour intégrer de nouvelles cibles et nouveaux·elles acteur·rice·s.
R2 – Les barrières à l’accès aux services et produits de santé existants sur l’ensemble du continuum de soins, y compris celles liées au genre ou à l’orientation sexuelle, sont identifiées, évaluées et partagées de façon continue par les acteur·rice·s communautaires et du système de santé formel des pays cibles.
OS3 – Influencer les politiques de lutte contre le VIH aux niveaux local, national et régional en intégrant les recommandations issues des observatoires communautaires et les nouveaux standards de la lutte contre le VIH
R1 – Les associations partenaires du Programme forment et mobilisent un réseau d’acteur·rice·s, participant au renforcement des synergies entre systèmes de santé communautaire et formel.
R2 – Les stratégies de plaidoyer et de communication du Programme valorisent les bonnes pratiques identifiées par les observatoires communautaires et les actions des parties prenantes, notamment dans la prise en compte du genre et des orientations sexuelles.
OS4 – Pérenniser les observatoires communautaires en garantissant une capitalisation continue et une reconnaissance nationale et régionale.
R1 – Un mécanisme de suivi-évaluation et de capitalisation continue est défini et mis en œuvre tout au long du projet.
R2 – Les observatoires communautaires sont reconnus comme outils complémentaires de veille sanitaire et sont intégrés aux stratégies nationales de lutte contre le VIH/sida et dans les propositions pays auprès de bailleurs.
ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE À ÉVALUER :
Réseaux de partenaires et modèle de Gouvernance
Les associations partenaires du programme FORSS sont constamment amenées à créer des réseaux partenariaux, sur lesquels s’appuyer pour les validations et les diffusions des résultats de l’observatoire. Les ateliers nationaux de lancement des observatoires, qui ont eu lieu dans les 4 pays de mise en œuvre ont permis de (ré)activer un tissu partenarial de membres anciennement engagés dans la Phase 1 du programme FORSS ou nouvellement intégrés. En outre, le modèle de gouvernance du programme a été renforcé avec notamment la création et l’organisation des COPIL élargis, intégrant des acteurs externes (CCM, ONUSIDA, Bailleurs, associations, etc.). Ainsi, les acteur·rices nationaux et régionaux sont pleinement impliqués dans le processus de mise en œuvre.
Formation des RHS et AC
Solidarité Sida et ITPC-MENA ont co-construit un programme de formation pour les Ressources Humaines en Santé et les Acteurs Communautaires dans le but de consolider leurs connaissances et de favoriser les synergies entre système de santé formel et communautaire. En novembre 2023, la formation régionale des formateur·rice·s a été organisée en présentiel à Nouakchott en Mauritanie auprès de binômes de formateur·rice·s. A la suite de cette formation régionale, les quatre binômes de chaque pays ont animé des sessions nationales auprès des groupes de RHS et AC pré-identifiés. Un système d’évaluation a été mis en place afin de mesurer l’impact des formations et adapter les sessions de recyclage pour garantir la durabilité des connaissances et des compétences acquises.
Actualisation de la méthodologie de collecte et formation
Suite à la mise en place d’études baselines diffusées auprès des autorités nationales et parties prenantes, la méthodologie de collecte, comprenant la révision des questionnaires, a été actualisée par ITPC-MENA et Solidarité Sida, en collaboration avec les associations partenaires. Ainsi, les protocoles de collecte, spécifiques à chaque pays, ont été mis à jour, soumis et validés par un comité éthique national. A noter que dans chaque pays, les zones d’intervention des observatoires ont été élargies, de même que les cibles, afin d’avoir des résultats extrapolables et plus représentatifs au niveau national.
En février 2024, une formation régionale à Tunis a été organisée pour renforcer les capacités des équipes projet des 4 pays sur la méthodologie de collecte. Par la suite, des sessions nationales combinant les formations des collecteurs et superviseurs ont eu lieu, visant à établir une base commune de connaissances et à renforcer le travail d’équipe. Pour limiter les risques liés au turn-over des collecteur·rices et superviseur·es, les équipes projet ont formé davantage de personnes pour garantir des remplacements rapides et préserver la continuité des activités de collecte.
Collecte, analyse et valorisation des données
Depuis juin 2024, 3 observatoires communautaires sur quatre (Mauritanie, Maroc, Tunisie) sont opérationnels. Après chaque trimestre de collectes les partenaires sont amenés à effectuer des rapports d’observatoires nationaux internes afin d’identifier les barrières d’accès aux soins des PVVIH et PC pour adapter leurs stratégies de plaidoyer et améliorer l’accès aux services VIH/Sida. Fin d’année 2024, les équipes projet ont suivi une formation sur-mesure concernant l’analyse de données des observatoires VIH de FORSS. A l’issue de cette formation, le format des rapports et les modalités de restitution ont été repensés pour optimiser l’impact de leur diffusion et l’appropriation des données par les parties prenantes.
Au Liban, compte tenu du contexte sécuritaire dégradé et face à l’impossibilité de mener les activités prévues, les équipes projet ont créé une enquête simplifiée pour analyser les besoins prioritaires des PVVIH et PC en situation de crise.
Plaidoyer
Durant la période, les partenaires ont été accompagnés par la Coordination projet sur la mise en place d’une stratégie de plaidoyer et de mobilisation des alliés lors de plusieurs cycles d’atelier régionaux. A cet effet, un plan de plaidoyer par pays a été élaboré. En parallèle, chaque association a travaillé sur une cartographie des observatoires existants afin d’identifier des alliés potentiels pour optimiser les ressources et maximiser l’impact des actions entreprises. En outre, la participation des partenaires FORSS à un atelier co-organisé par le GFAN et ITPC-MENA en février 2024 sur le thème « Soutenir le plaidoyer dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord en prévision de la 8e reconstitution des ressources du Fonds mondial » permettra de coordonner les efforts régionaux tout en favorisant les échanges et les synergies pour une mobilisation accrue des financements, notamment ceux concernant la pérennisation des observatoires communautaires.
Capitalisation
La Coordination a mis un accent particulier sur la capitalisation des connaissances et des pratiques. À cette fin, plusieurs ateliers ont été organisés pour effectuer une capitalisation continue et développer une boîte à outils portant sur le modèle des observatoires VIH en région MENA basé sur l’expérience FORSS. Cette boîte à outils, à destination d’un public extérieur offrira, entre autres, des ressources et des directives pour l’établissement et la gestion efficaces d’observatoires VIH dans la région MENA, facilitant la collecte et l’analyse des données pour l’amélioration de la prise en charge des PVVIH et PC. Ces initiatives visent non seulement à consolider les acquis du programme, mais aussi à servir de levier pour influencer les politiques, intégrer les observatoires dans les plans stratégiques nationaux (PSN) et contribuer aux objectifs d’accélération de la riposte d’ici 2030.
Communication et valorisation du programme
Durant ce semestre, la coordination et les équipes projet ont travaillé sur un plan de communication qui vise à soutenir les efforts de lutte contre le VIH dans la région MENA, en facilitant l’intégration des observatoires communautaires dans les Plans Stratégiques Nationaux. Il s’articule autour de quatre axes principaux : i) améliorer les connaissances des acteurs de santé, ii) diffuser des données sur les barrières d’accès aux soins, iii) déployer des stratégies de plaidoyer, et iv) pérenniser les mécanismes de veille communautaire. Divers médias et canaux de communication ont été sélectionnés : rapports d’observatoires, capsules vidéos, site internet, newsletter, événements (ateliers de restitution), réseaux sociaux, etc.
A noter que la participation des équipes projet et/ou de la Coordination à l’AFRAMED et l’AFRAVIH ont permis de donner de la visibilité au programme FORSS.
Bénéficiaires du projet
Le projet cible directement les équipes projet des 5 associations partenaires (ITPC-MENA, RdR-Maroc, AGD, ATL, et Marsa), ainsi que des acteur·rice·s communautaires et du système de santé formel des quatre pays cibles (Maroc, Tunisie, Mauritanie, Liban). S’ajoutent à ces cibles l’ensemble des répondant·e·s aux questionnaires et participant·e·s aux focus-groups.
Les bénéficiaires indirect·e·s du projet sont les PVVIH ainsi que les populations clés des pays cibles qui bénéficieront de services de meilleure qualité, adaptés et en adéquation avec leurs besoins et attentes.
Budget du projet
Le coût total de l’action a été évalué à 2 159 126 euros sur 36 mois. Le projet est financé à 90% par l’Initiative.
JUSTIFICATION DE L’ÉVALUATION
Le projet a démarré le 1er mai 2023 et sa clôture est fixée au 30 avril 2026. La présente évaluation est donc une évaluation intermédiaire de l’action, prévue dans le cadre de la convention signée entre Solidarité Sida et l’Initiative. Elle couvre la période allant du 1er mai 2023 au 30 mars 2025.
Cette évaluation doit permettre de :
- Apprécier les évolutions du programme entre la première et la deuxième phase
- Dresser un bilan de l’action en termes de pertinence, cohérence, adaptabilité, efficacité et efficience du Programme ;
- Formuler des recommandations pour l’amélioration des acquis du Programme et sa pérennisation
OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION ET RÉSULTATS ATTENDUS
Objectif 1 : Évaluer les objectifs, résultats et activités du Programme
- Fournir un bilan qualitatif et quantitatif des activités réalisées, incluant une analyse détaillée de leur pertinence et contribution aux objectifs du programme ;
- Mesurer l’atteinte des résultats attendus et indicateurs du Programme à mi-parcours ;
- Identifier les écarts entre les résultats obtenus et les attendus du Programme et analyser les causes
- Identifier les ajustements nécessaires pour optimiser la mise en œuvre et maximiser l’impact des activités restantes tout en prenant en compte la complexité du contexte d’intervention de chaque partenaire de mise en oeuvre
Objectif 2 : Analyser la gouvernance et les mécanismes de pilotage du Programme
- Évaluer l’efficacité et la pertinence du modèle de gouvernance
- Évaluer la pertinence (réponse aux besoins des partenaires) et l’appropriation des outils de compréhension et de gestion du Programme développés
- Évaluer l’efficacité des mécanismes d’accompagnement, de concertation et de prise de décision mis en place.
Objectif 3 : Apprécier les effets et impacts du Programme
- Analyser les changements survenus au niveau des « groupes cibles » et déterminer la contribution du projet à ces changements. Il s’agira notamment d’identifier les effets induits et les impacts :
- pour les partenaires de mise en oeuvre depuis la phase 1 : AGD et RdR Maroc
- pour les partenaires de mise en oeuvre depuis la phase 2 : ATL et Marsa
- pour les associations coordinatrices du projet : Solidarité Sida et ITPC-MENA
- sur les bénéficiaires indirects du projet
- Apprécier les points forts et points d’amélioration du projet, avec une analyse plus particulièrement approfondie sur la durabilité du projet
- Formuler des recommandations et proposer des orientations préliminaires sur la pérennisation de futurs projets d’observatoires communautaires en région MENA. Les conclusions de l’étude nourriront la réflexion sur le futur du programme FORSS.
Méthodologie
L’évaluateur·trice devra soumettre une proposition méthodologique dans laquelle il·elle décrira sa démarche d’évaluation, ainsi qu’une liste de questionnements relatifs aux objectifs définis ci-dessus.
La méthode proposée devra tenir compte des points de vue de l’ensemble des partenaires du Programme et intégrer :
Une phase de préparation de la mission d’évaluation qui portera sur :
- L’élaboration d’une note de cadrage de l’évaluation présentant la méthodologie les acteurs parties prenantes, le calendrier de la phase de collecte et la matrice des questions évaluatives afin de valider les orientations proposées.
- Une analyse documentaire à partir de l’examen des documents du projet (évaluations intermédiaire et finale FORSS I, conventions et avenants FORSS II, plan d’action, cadre logique, chronogramme), ainsi que les rapports de mission de suivi de Solidarité Sida, et les rapports semestriels transmis à l’Initiative ;
- Une réunion de cadrage méthodologique de l’évaluation ainsi que des échanges entre Solidarité Sida et l’évaluateur·rice afin de garantir la bonne compréhension et le respect des termes de référence de l’évaluation.
Une phase de conduite de l’évaluation qui devra inclure :
- Des entretiens téléphoniques/visioconférence ou des questionnaires par email afin de recueillir les points de vue des équipes de Solidarité Sida et des associations partenaires, du bailleur et d’autres parties prenantes pouvant être recommandées (représentant·e·s CCM, représentant·e·s du système de santé formel, acteur·rice·s communautaires, etc) ;
- L’analyse des informations recueillies et l’intégration de recommandations concrètes dans le contenu de l’évaluation.
Une phase de restitution de l’évaluation qui s’effectuera après remise du rapport provisoire global. Une réunion de restitution et d’échanges sur les conclusions du rapport sera organisée dans les locaux de Solidarité Sida à Paris, en présence du Directeur des Programmes, de l’Adjointe à la Direction des Programmes, la Responsable Programmes MENA, la Chargée de programmes et du Chargé de suivi administratif et financier. L’équipe d’ITPC-MENA, en tant que coordinateur du Programme sera également conviée.
Le rapport final de 20 à 30 pages maximum (sans annexes) et un résumé de 4 pages sera présenté en respectant les exigences de Solidarité Sida et de l’Initiative. A minima, il devra comporter les parties suivantes :
- Résumé
- Table des matières
- Liste des acronymes
- Introduction
- Méthodologie, questions traitées
- Résultats et analyse par critères
- Appréciation globale
- Conclusions, leçons et recommandations
- Annexes qui devront notamment comporter :
- Le programme détaillé de la mission, ainsi que la liste des personnes et structures interrogées ;
- Les compte-rendu des échanges avec les différents partenaires du Programme.
L’évaluateur·rice peut proposer au commanditaire d’ajouter d’autres parties au rapport si celles-ci permettent de satisfaire aux objectifs de l’évaluation.
Les rapports provisoire et final seront rédigés en français, mais certaines annexes pourront être rédigées en anglais (notamment les compte-rendu des échanges avec les partenaires libanais).
Ressources humaines
Profil et compétences requises
L’évaluation sera conduite par un·e consultant·e ou une équipe de consultant·e·s externe·s ayant le profil suivant :
- Disposer d’une bonne expérience et expertise des exercices et processus d’évaluation dans un environnement multi-acteurs et de transferts d’expériences et de savoirs locaux, notamment des projets dans le domaine de la santé et de lutte contre le VIH/sida ;
- Capacité à développer une démarche impliquant les différentes parties prenantes du
programme ; - Bonnes connaissances de la région MENA et des acteurs de la société civile;
- Expertise sur les études d’effets et d’impacts de projets ;
- Maîtrise obligatoire du français et l’anglais ; l’arabe sera considéré comme un atout.
Impartialité et objectivité de l’évaluateur·rice
Afin que soit respectée la finalité de cette évaluation réalisée en externe, l’évaluateur·rice devra nécessairement faire preuve d’objectivité et d’impartialité, du début de la mission d’évaluation jusqu’à la validation du rapport final par Solidarité Sida et l’Initiative.
L’évaluateur·rice devra prendre en compte de façon équilibrée les différents points de vue légitimes qui peuvent être exprimés et conduire l’évaluation de façon impartiale. Cette prise en compte de la pluralité des points de vue doit se traduire, chaque fois que possible, par l’association des différentes parties prenantes au processus d’évaluation.
Par conséquent, l’évaluateur·rice ne peut être à ce jour membre ou salarié de Solidarité Sida, des associations partenaires ou d’Expertise France. Il·elle ne doit pas également avoir participé ou assisté à l’élaboration ou à la mise en œuvre du Programme évalué.
Organisation et calendrier prévisionnel
La phase de conduite de l’évaluation pourra commencer à partir d’avril 2025. Un calendrier prévisionnel est à proposer par l’évaluateur·rice dans son offre, en respectant ces dates fixes et en incluant les différentes phases de l’évaluation.
Le rapport d’évaluation, dans sa version provisoire, devra être remis à Solidarité Sida au plus tard le 4 juillet 2025. Après réception du rapport, des échanges se feront par mail, et l’évaluateur·rice animera une réunion de restitution du rapport provisoire dans les locaux de Solidarité Sida, à Paris (date à définir conjointement entre Solidarité Sida et l’évaluateur·rice).
La version finale du rapport sera adoptée au plus tard en septembre 2025. Le rapport ne pourra être rendu final qu’après validation par Solidarité Sida.
Il pourra également être demandé une restitution des conclusions du rapport à destination de l’Initiative ainsi que des partenaires de mise en œuvre du Programme ; le cas échéant, l’évaluateur·rice devra pouvoir se rendre disponible pour animer cette restitution.
Budget
L’offre budgétaire proposée par le·la candidat·e ne devra pas excéder 14 000 euros TTC. Elle devra inclure les honoraires, les frais de communication, le matériel nécessaire à la prise de note, à l’élaboration, à la production et diffusion du rapport final et tous frais inhérents à la conduite de la mission d’évaluation.
Modalités de candidature
Les candidat·te·s intéressé·e·s pour soumissionner doivent fournir un dossier de candidature composé des éléments suivants :
- Composition de l’équipe évaluatrice : CV détaillé du·de la ou des évaluateur·rices proposé·e·s et références en matière d’évaluation de programmes similaires ;
- Une offre technique (maximum 20 pages) comprenant au minimum les éléments suivants :
- Compréhension des présents termes de référence ;
- Méthodologie de travail et résultats attendus
- La méthodologie proposée pour atteindre les objectifs de l’évaluation de façon documentée et argumentée ;
- Les résultats attendus ;
- Les limites de l’évaluation ;
- Un calendrier indicatif détaillé ;
- Toute autre information permettant une bonne compréhension de la méthode utilisée.
- Une offre financière détaillée expliquant les différents coûts (HT et TTC).
Modalités de sélection
Soumission de la candidature
Les candidat·e·s sont invité·e·s à déposer leur offre par email exclusivement à Rindra RAVELOARISOA Adjointe à la Direction des Programmes (rraveloarisoa@solidarite-sida.org) et Marie-Charlotte Fargues, Responsable programmes MENA (mcfargues@solidarite-sida.org), au plus tard le 27 mars 2025 à 23h59 (heure de Paris), en indiquant en objet du mail « Évaluation intermédiaire Programme FORSS II – Candidature NOM Prénom ».
Les offres reçues après cette date ne seront plus considérées.
Les candidat·e·s peuvent demander de plus amples informations à Rindra Raveloarisoa et Marie-Charlotte Fargues, à ces mêmes adresses mail et ce au plus tard le 17 mars 2025 inclus. Au-delà de cette date, Solidarité Sida ne sera pas tenu de répondre aux questions posées.
Etapes de sélection
Une commission sera chargée de l’évaluation des dossiers de candidatures reçus.
Après analyse des offres, la commission pourra demander des précisions aux soumissionnaires quant à leur offre.
Une fois les éventuelles précisions données, la commission procèdera à la sélection du ou des soumissionnaires selon les critères d’attribution définis.
La sélection sera ensuite soumise à la validation de l’Initiative, conformément aux procédures de ce bailleur.
Critères de l’attribution
Le marché sera attribué à l’offre jugée techniquement la mieux disante, c’est-à-dire techniquement la meilleure (qualité de l’offre technique, expériences du/des prestataires) et financièrement réaliste (coûts unitaires en accord avec les coûts du marché et coût total inférieur au budget disponible).
Une attention particulière sera apportée à l’expérience, références à l’appui, du·de la candidat·e ou de l’organisme pour des missions similaires.
CALENDRIER
| Date | |
| Date limite de demande d’informations complémentaires | 17 mars 2025 |
| Date limite de soumission des offres | 27 mars 2025 à 23h59 (heure de Paris) |
| Date indicative de début de la prestation (avec réunion de cadrage) | 7 avril 2025 |
| Remise du rapport provisoire | FIn mai 2025 |
| Réunion de restitution et de présentation du rapport provisoire | Début juin 2025 |
| Remise du rapport final | Fin juin 2025 |
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
| AGD | Association des Gestionnaires pour le Développement |
| ARV | Antirétroviraux |
| ATL MST SIDA | Association Tunisienne de Lutte MST SIDA |
| MENA | Middle East and North Africa (Moyen-Orient et Afrique du Nord) |
| ITPC | International Treatment Preparedness Coalition |
| PVVIH | Personne vivant avec le VIH |
| PC | Population clé |
| RDR-Maroc | Réduction des risques Maroc |
| VIH | Virus de l’immunodéficience humaine |
Vous souhaitez déposer un appel d’offre ?
Déposez vos appels d'offres pour vos recherches de prestations visant à renforcer votre organisation, faciliter vos projets...
Déjà inscrit ?
L’ABC des prestataires
Plus de 50 prestataires référencés dans notre base !
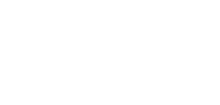
Tout chaud
Nous ne sommes pas des cibles : stop à l’impunité
3 questions à Sophie Lehideux, Membre du comité de décision FRIO
Appel à une transformation de l’action humanitaire