Evaluation Finale du programme « Ensemble pour la paix » en Colombie
NOTE D’INFORMATION DU PROJET
Présentation du projet:
La Colombie s’est engagée dans un long processus de construction de la paix, suite à la signature de l’Accord de paix entre la guérilla des FARC et l’Etat colombien en 2016, et plus récemment avec le projet de paix totale du gouvernement Petro. S’appuyant sur une phase pilote (2017-2020) et une phase 1 (2020-2023), cette nouvelle phase du projet Ensemble pour la paix, mis en œuvre par un consortium de 8 ONG françaises et 12 ONG colombiennes, vise à poursuivre le soutien aux dialogues entre société civile et autorités publiques et aux initiatives de paix locales dans 3 zones rurales de la Colombie, dans les départements du Chocó et du Cauca.
Cette phase du projet vise à : (R1.1) consolider 3 agendas territoriaux pour la construction de la paix, à partir d’une étude préalable permettant de prioriser l’action du consortium, (R1.2) renforcer les capacités des OCB, via la mise en place d’un fonds d’initiatives de paix, d’une école de gestion territoriale, d’un fonds de protection et l’organisation d’échanges inter-territoriaux, (R2.1) renforcer la stratégie de plaidoyer multi-acteurs et multi-niveaux du consortium, afin de visibiliser les initiatives de paix territoriale, et (R2.2) renforcerles alliances du consortium et sa dynamique de travail collective.
Durée du projet : 3 ans
Date de début : 1er mars 2023
Principaux partenaires du projet :
Partenaires en France : Réseau France Colombie Solidarités (RFCS) : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT), Agir Ensemble pour les Droits Humains (AEDH), CCFD-Terre Solidaire, Ecole de la Paix, France Amérique Latine, Travailler Ensemble Jeunes et Engagés (TEJE), Peace Brigades International-France, Secours Catholique-Caritas France
Partenaires en Colombie : CINEP, CCDE, CIJP, Amis de l’UNESCO, CIASE, Vamos Mujer, Enfances 2/32, ILSA, SNPS – Caritas Colombie, Taller abierto, Minga
Coût total du projet : 1.477.779 €
Lieu d’intervention : COLOMBIE
- Région du Bajo Atrato dans le département du Chocó, municipalités de Riosucio, Carmen del Darien, Belen de Barijá, et Unguia,
- Région du Nord du Cauca et Sud du Valle del Cauca, municipalités de Santander de Quilichao, Caloto, Toribío, Corinto, Jambaló, Villa Rica, Puerto Tejada, Caldono, Florida
- Région du Littoral pacifique du Cauca, municipalités de Guapi, Timbiqui, Lopez de Miquay, Iscuandé
| OBJECTIF GLOBAL : Contribuer à la construction de la paix territoriale en Colombie, dans une perspective de dialogues multi-acteurs et multi-niveaux |
Indicateur 1. À la fin du projet, les organisations de la société civile auront influencé la définition et le développement de plans et de politiques liés à la paix au niveau territorial et national.
Indicateur 2. Les instances de coopération internationale (ONU, autorités françaises et européennes) renforcent leurs mesures de soutien à la construction de la paix, en particulier dans les domaines de la protection des leaders, le soutien au SIVJRNR, la construction d’accords de paix avec les acteurs armés, en prenant en compte de manière transversale les approches de genre, de jeunesse et ethnique.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1. Les Organisations Communautaires de Base (OCB), renforcées dans leurs capacités organisationnelles et de plaidoyer, participent à la construction d’agendas territoriaux de paix, en concertation avec les autorités locales et/ou nationales
Indicateur 1. Les communautés autochtones, afro-descendantes et paysannes du Cauca et du Chocó ont participé et positionné leurs messages de plaidoyer communs, par le biais de leurs organisations représentatives, dans les espaces de dialogue avec les autorités pour la construction de la paix (espaces du SIJVRN, de l’Accord de paix, espaces créés par la politique de paix totale…).
Résultat 1.1. Les membres du programme et les OCB sur chaque territoire consolident un agenda territorial de construction de la paix
Activités : Réalisation d’une étude thématique régionale, Construction d’un agenda commun de construction de paix territoriale, Dialogues multi-acteurs locaux et nationaux, Plaidoyer auprès des instances législatives et exécutives en lien avec l’agenda de paix sur les territoires, Suivi et documentation de l’agenda sur le territoire. Indicateurs de suivi des activités : 3 rapports régionaux seront disponibles, 9 espaces de concertation organisés, au moins 18 dialogues multi acteurs auront été convoqués, Organisation d’une action publique concertée avec une instance gouvernementale ou législative, 36 réunions de suivi.
Indicateurs de résultat : i. à la fin du projet, un agenda territorial de paix a été construit collectivement et validé par 80% des OCB alliées et autres acteurs sociaux clés sur chaque territoire; ii. A la fin du projet, 90% des organisations du consortium et les OCB alliés sur chaque territoire considèrent que la création de l’agenda territorial a renforcé les liens de coopération entre les OSC et favorisé la définition de messages de plaidoyer communs.
Résultat 1.2. Les OCB renforcent leurs processus de résistance territoriale et leur influence politique aux niveaux local, départemental, national et international
Activités : Organisation d’une école de paix territoriale, fonds d’initiatives de paix, mise en œuvre d’un fonds de protection intégrale, échanges d’expériences entre les 3 territoires. Indicateurs de suivi des activités : au terme du projet, 27 ateliers de formation par an auront été organisés, au moins 6 initiatives de paix ont été soutenues, 10 leaders sociaux dont au moins 60% de femmes, auront reçu un appui du fonds d’urgence, 3 ateliers de protection collective organisés, 2 échanges entre les trois territoires.
Indicateur de résultat : A la fin du projet, au moins 90% des OCB considèrent que leur participation aux différentes activités leur ont permis de renforcer leurs capacités de plaidoyer et de dialogue avec les autorités.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2 : 2. L’alliance stratégique des organisations du programme est renforcée pour le plaidoyer politique dans les espaces régionaux, nationaux et internationaux
Indicateur 2. Des messages de plaidoyer régionaux et nationaux et des recommandations du consortium en termes de consolidation de la paix ont été intégrés à l’agenda international.
Résultat 2.1. Le programme et ses alliés positionnent leurs messages de plaidoyer pour la consolidation de la paix territoriale et la mise en œuvre intégrale de l’accord de paix auprès des autorités locales, nationales et de la communauté internationale.
Activités : Actualisation de la stratégie commune de plaidoyer, Elaboration et publication de notes d’information et de matériel de communication, Mise en place d’une alliance avec la Revue Raya, Organisation de réunions d’échange et de plaidoyer avec les autorités régionales, nationales et internationales, Tournées de représentants locaux et nationaux des membres et OCB alliées du programme en France et à Bruxelles, Tournée à New York auprès du Conseil de sécurité de l’ONU, Organisation d’évènements publics de plaidoyer et de sensibilisation. Indicateurs de suivi des activités : 1 stratégie de plaidoyer commune actualisée, publication d’au moins 18 supports de communication, 3 reportages publiés en lien avec la revue Raya, au moins 48 réunions de plaidoyer organisées, 3 tournées des défenseurs des droits humains colombiens et colombiennes auront été organisées, 4 évènements publics (2 en France et 2 en Colombie) auront été organisés
Indicateurs de résultat : A la fin du projet, au moins 20 produits médiatiques externes (articles, programmes radio, contenu web, etc.) auront visibilisé le rôle positif du consortium dans la consolidation de la paix en Colombie, et le nombre d’abonnés aux réseaux sociaux du programme aura augmenté de 80%
Résultat 2.2. Le programme élargit son réseau d’alliés et partage ses leçons apprises et ses bonnes pratiques en termes de concertation des agendas territoriaux pour la construction de la paix et de plaidoyer multi-niveaux.
Activités : Organisation de rencontres pour l’établissement de nouvelles alliances, Processus de capitalisation, Participation à la feuille de route de l’Union Européenne et autres espaces dédiés au partage d’expériences entre OSC. Indicateurs de suivi des activités : au moins 10 OSC et/ou universités auront participé en tant qu’intervenant ou auront apporté une expertise lors d’évènements du programme, et le consortium intégrera au moins 2 nouveaux membres, renforcement du kit de capitalisation, partage de bonnes pratiques du programme dans au moins 3 rencontres organisées par la feuille de route de l’UE ou autres réseaux d’OSC d’OSC en Colombie.
Indicateurs de résultat : À la fin du projet, le consortium aura entretenu un dialogue régulier et partagé ses bonnes pratiques avec plus de 10 OSC, plateformes et/ou universités.
Résultat 2.3. Le programme renforce sa dynamique de travail et son articulation collective.
Activités : Révision et appropriation du manuel de procédures et de communication interne, Organisation de séminaires-ateliers internes, Organisation des Assemblées Générales du consortium, Construction d’une stratégie commune de cofinancement. Indicateurs de suivi des activités : 1 manuel de procédures et communication interne révisé, 9 séminaires internes organisés, 1 Assemblée Générale organisée chaque année, 1 stratégie commune de cofinancement élaborée, au moins 2 demandes de cofinancement approuvées.
Indicateurs de résultat : 80% des organisations membres convoquées aux instances de gouvernance et aux séminaires internes y participent, avec des apports et propositions.
Groupes cibles :
Bénéficiaires direct·es : Au moins 550 représentant·e·s, dont au moins 60% de femmes, et 30% de jeunes, d’organisations de la société civile participant aux activités de renforcement des capacités provenant : i) des 20 organisations membres du consortium, ii) des 172 organisations communautaires de base accompagnées, représentées sous différentes formes, parmi lesquelles : 52 organisations de la société civile, dont 18 associations de femmes ou dirigées par des femmes et 11 associations de jeunes ; 33 conseils autochtones ; 81 conseils communautaires afro descendants ; 6 zones humanitaires. Au moins 360 participant·e·s aux activités et événements de plaidoyer (représentant·e·s institutionnel·le·s, d’OSC, de citoyen·nes).
Bénéficiaires indirect·es : 477.228 habitant·e·s de 17 municipalités du Chocó et du Cauc
I. LE PROGRAMME ET LES ACTEURS IMPLIQUÉS
Depuis sa création en 2012, le Réseau France Colombie Solidarités (RFCS) rassemble des associations françaises qui œuvrent à la construction d’une paix durable en Colombie, à travers des actions de plaidoyer et de soutien à des partenaires de la société civile colombienne. Suite à la signature de l’Accord de paix en 2016 entre l’Etat colombien et la guérilla des FARC, le RFCS impulse une réflexion collective avec ses partenaires sur les modalités de soutien à la mise en œuvre de l’Accord et à la consolidation d’une culture de paix et de dialogue en Colombie. Le travail conjoint et le dialogue entre les organisations colombiennes et françaises aboutit à la création du programme Ensemble pour la paix en 2017, un programme de soutien à la construction de la paix territoriale dans 3 régions de la Colombie, à travers le renforcement des capacités des organisations de la société civile, le plaidoyer multi-niveaux et l’ouverture de dialogues multi-acteurs pour la construction de la paix. La vision de construction de la paix du programme est territoriale : la paix se construit d’abord au sein des communautés les plus affectées par le conflit, dans le respect de leurs cosmovisions. La consolidation de la paix est transversale et travaillée à travers différents enjeux de justice transitionnelle, de participation citoyenne, de protection des défenseurs des droits humains, d’éducation et protection des jeunesses, d’égalité de genre, entre autres.
Le programme se rassemble en Assemblée Générale une fois par an, et nomme un Comité de pilotage (COPIL) franco-colombien, en charge du suivi stratégique du programme. Trois groupes territoriaux, composés des organisations membres ayant une longue expérience de l’accompagnement d’organisations communautaires sur le territoire, sont responsables de la conception et mise en œuvre de la stratégie d’intervention du projet sur chaque territoire. Des groupes de travail fournissent un soutien méthodologique et technique sur différents thèmes et activités (genre, protection, plaidoyer). Enfin, une unité de coordination est chargée du pilotage et suivi des différentes activités. Elle est composée de trois animateurs territoriaux, d’une coordination nationale et d’une chargée de plaidoyer et de communication en Colombie, du coordinateur du RFCS et d’une coordinatrice générale en France.
Depuis sa création, le programme Ensemble pour la paix est cofinancé par l’Agence Française de Développement (AFD). La phase actuelle 2023-2026 est également soutenue par le Secours Catholique, le CCFD-Terre solidaire, et l’Agence Présidentielle de Coopération colombienne.
II. EVALUATION
A. Justification de l’évaluation
La phase actuelle du programme prend fin le 28 février 2026. Toutefois, le collectif souhaite poursuivre son action, et prépare la formulation d’une troisième phase du programme, qui sera présentée à l’AFD en juin 2026. Certains enjeux seront abordés lors de la formulation de cette nouvelle phase, notamment les suivants :
- Identité du collectif: de nouveaux membres seront-ils inclus ? si oui, lesquels et sur quels critères ?
- Gouvernance et structure: y at-il des changements à opérer dans la structure de gouvernance et les flux d’information ?
- Territoires: de nouveaux territoires seront-ils couverts par le programme ? si oui, lesquels et sur quels critères ?
- Thématiques : quels seront les axes thématiques prioritaires de la prochaine phase, en lien avec l’analyse du contexte et les perspectives de participation aux dialogues de paix ? Quels seraient les éléments d’innovation et de consolidation du programme ?
- Alliances et acteurs : dans la logique multi-acteurs et multi-niveaux, quelles sont les alliances ou le plaidoyer stratégique à renforcer dans la prochaine phase ?
- Pérennité : souhaitons-nous pérenniser le programme à la fin de cette troisième phase ? Si oui, comment ?
Le rapport d’évaluation doit donc apporter, non seulement des conclusions sur l’analyse des résultats et des impacts de l’action, mais aussi identifier les forces et défis du programme et émettre des recommandations qui seront prises en considération pour la poursuite de l’action dans une prochaine phase. L’objectif général de cette évaluation est d’apprécier les résultats du projet ainsi que les effets des actions menées par rapport aux objectifs attendus. À cette fin, ses objectifs spécifiques sont les suivants :
- Analyser selon les critères du CAD – pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact et viabilité – les réalisations du projet par rapport aux objectifs, résultats et indicateurs définis dans le cadre logique.
- Examiner comment les objectifs et résultats du projet ont été atteints et comment les impacts et résultats se sont produits grâce au projet en ayant une attention particulière au renforcement des capacités des OCB ciblées.
- Évaluer la qualité et les impacts de la mise en œuvre de l’approche de genre dans les activités du programme.
- Évaluer la qualité et les impacts de la mise en œuvre de l’approche de protection dans les activités du programme.
- Évaluer l’efficacité de la structure organisationnelle mise en place (gouvernance, coordination, processus de prises de décision, structure administrative et financière) et formuler des recommandations pour son amélioration pour une prochaine phase du programme. Un focus sera également apporté sur le rôle qu’a joué les organisations membres dans l’atteinte ou pas de ces résultats ou impacts. L’évaluation devra démontrer si le format consortium colombo-français a joué un effet positif dans l’atteinte ou pas de ces résultats
Par ailleurs, l’évaluation devra prendre en considération :
- Les rapports d’évaluation finale de la phase pilote (2017-2020) et de la phase 1 (2020-2023) afin de prendre en compte les analyses et recommandations émises,
- Le rapport de l’étude de capitalisation de la phase 1 (2020-2023) qui a été mené afin de partager les apprentissages du programme en termes de dialogue multi-acteurs pour la construction de la paix territoriale.
Certains éléments de cette étude pourront servir à l’analyse et à la réalisation du rapport d’évaluation finale.
B. Questions de référence des critères de l’évaluation
- Pertinence :
- La logique d’intervention du programme est-elle toujours pertinente dans le contexte actuel pour répondre aux besoins des bénéficiaires ciblés, de manière différenciée (peuples autochtones, afro, femmes, jeunes) ?
- La logique d’organisation en un consortium colombo-français était-elle pertinente pour atteindre les objectifs fixés ?
- Les méthodologies utilisées pour le renforcement des capacités et le travail de plaidoyer multi-niveaux étaient-elles pertinentes pour atteindre les objectifs fixés ?
- Le système de Suivi et Évaluation du projet était-il pertinent ?
- La formulation des indicateurs de résultats était-elle pertinente pour mesurer les effets et impacts du programme ? Comment peut-elle être améliorée en vue d’une prochaine phase du programme ?
- Le programme a-t-il su adapter ses activités aux contextes locaux et au contexte national ?
- Dans quelle mesure le programme a-t-il été intégré dans les plans d’action stratégique des membres du consortium ?
- Dans quelle mesure le programme a-t-il été coordonné avec d’autres alliés et interventions similaires dans un souci de synergie ?
- Dans quelle mesure les autorités locales se sont-elles saisies des enjeux et des initiatives proposées par le programme ?
- Dans quelle mesure les politiques du gouvernement ont-elles soutenu ou affaibli l’action du programme ?
- Les ressources mobilisées ont-elles permis la correcte mise en œuvre des activités ?
- Les ressources mobilisées ont-elles été utilisées et gérées de manière efficace ?
- Le système de suivi de l’action au sein du consortium est-il efficace ?
- Les résultats et objectifs du projet ont-ils été atteints dans les délais prévus ?
- La structure de gouvernance du programme, et en particulier les processus de décision, sont-ils agiles pour mettre en œuvre la stratégie du programme ? Comment la gouvernance peut-elle être améliorée ?
- La structure administrative et financière du programme est-elle agile pour mettre en œuvre la stratégie du programme ? Comment peut-elle être améliorée ?
- Y a-t-il des facteurs et des limites internes qui ont affecté la mise en œuvre du projet, en termes de méthodologies d’intervention, d’organisation, de gestion ?
- Y a-t-il des facteurs et des limites externes qui ont affecté la mise en œuvre du projet, en termes de contexte politique, socio-économique et sanitaire, ou autres imprévus ?
- Impacts
- Quels ont été les principaux impacts (positifs/négatifs, attendus/inattendus) tels que perçus par les différents acteurs et bénéficiaires du projet ?
- Y a-t-il des expériences exceptionnelles qui devraient être mises en évidence, par exemple des histoires, des bonnes pratiques, des changements dans les politiques locales, etc. ?
- La formulation des résultats et des indicateurs de résultat dans le cadre logique est-elle adaptée pour mesurer et documenter les impacts de l’action ? Quelles améliorations pourraient être apportées au cadre logique en vue de l’étude des effets attendus en phase 3 du programme ?
5.1. Impacts politiques
- Quel impact le programme a-t-il eu sur les dynamiques régionales de construction de la paix ? Des agendas de paix ont-ils été inclus dans les plans de gouvernance locale (plans de développement, plans locaux, etc.) ?
- Le programme a-t-il eu un impact positif en ce qui concerne la garantie des droits (droits à l’autonomie, participation politique…) ?
- Le programme a-t-il renforcé l’interaction entre divers acteurs, entre les organisations de la société civile, et entre la société civile et les autorités locales ?
- Avec l’arrivée au pouvoir de Gustavo Petro en 2022 et la mise en place de sa politique de paix totale favorisant le dialogue entre les institutions et la société civile, les dialogues territoriaux pour la construction de la paix ont-ils été effectivement facilité ?
5.2. Impacts sur le renforcement des capacités
- Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à construire une compréhension et une vision communes de la construction de la paix au sein du consortium ?
- Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à renforcer les capacités des OCB à dialoguer, effectuer un travail de plaidoyer et positionner des propositions de paix territoriale ? Quelles actions concrètes des OCB permettent-elles de démontrer ce renforcement de capacités ?
- Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à renforcer le leadership et la participation citoyenne des communautés ?
- Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à renforcer les capacités des femmes, notamment leur participation dans des agendas de construction de la paix ? Comment cela se traduit-il concrètement ?
- Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à renforcer les capacités des jeunes, notamment leur participation dans des agendas de construction de la paix ? Comment cela se traduit-il concrètement ?
- Dans quelle mesure l’approche de genre a-t-elle été mise en œuvre au sein des initiatives de paix ? Comment celle-ci s’est-elle déclinée concrètement ? Quels en ont été les impacts ?
5.3. Impacts du plaidoyer et de la communication
- Quels ont été les principaux impacts du travail de plaidoyer et de communication du programme ?
- Le programme a-t-il contribué à positionner et visibiliser les agendas territoriaux de construction de la paix ? Comment cela se traduit-il concrètement ?
- Quels impacts le travail de plaidoyer a-t-il eu en France, en termes de visibilité de la construction de la paix territoriale, d’interaction avec divers acteurs et de création d’alliances?
- Quelles bases le programme a-t-il permis de poser jusqu’à présent pour assurer sa viabilité ?
- Y a-t-il un sentiment d’appropriation du projet par les membres du programme et les communautés locales ?
- Dans quelle mesure l’implication et la participation des OCB ont-elles été assurées dans l’identification, la planification et la mise en œuvre du programme ?
- Qu’est-ce que le projet aurait pu faire différemment pour améliorer sa viabilité ? Quels enseignements le programme peut-il tirer pour assurer sa viabilité au cours d’une prochaine phase ? Quelles adaptations peut-il mettre en place en ce sens ?
- Quelles sont les actions prioritaires identifiées pour une phase 3 qui devra décliner une stratégie de sortie de son financement AFD ?
- Des organisations ont-elles déjà été identifiées qui pourraient rejoindre le consortium lors de la prochaine phase ? Si oui, lesquelles ? Serait-ce pertinent d’inclure de nouveaux membres dans une prochaine et dernière phase du programme ?
- Y a-t-il des recommandations spécifiques concernant les changements à apporter à la structure de gouvernance pour la prochaine phase, notamment en termes d’impact et de viabilité ?
- La couverture territoriale du programme est-elle toujours pertinente en vue d’une prochaine phase du programme ? Celle-ci aurait-elle intérêt à être resserrée ou étendue ? Si oui, selon quels critères ?
- Des éléments d’innovation et de consolidation ont-ils été identifiés pour la prochaine phase ?
C. Méthodologie et étapes
Voici quelques éléments sur les méthodes et les grandes étapes attendues de l’évaluation :
Phase 1. Préparation et documentation
- Réunion de cadrage
- Analyse de la documentation disponible : L’équipe de consultant.es procédera à un examen rigoureux des documents tels que la NIONG du projet, le cadre logique, les rapports d’avancement, les publications et comptes rendus d’activités, le matériel et documents sur différents sujets utilisés pour la mise en œuvre du projet (vidéos, bulletins d’information, etc.).
- Préparation par l’équipe de consultants d’une note de cadrage de l’évaluation présentant la méthodologie adaptée, les objectifs, les questions, le plan de travail proposé, ainsi que les outils à utiliser pour l’évaluation (questionnaires, guides d’entretien, le cas échéant).
- Validation de la note de cadrage et réunion avec l’unité de coordination et les principaux partenaires impliqués afin de préparer la mission de terrain
Durée estimée : 10 jours
Phase 2. Mission de terrain (Colombie et France)
- Entretiens en présentiel ou en visioconférence avec les acteurs clés du programme : unité de coordination et membres du consortium
- Entretiens avec les bénéficiaires cibles : représentant.e.s des OCB menant des initiatives de paix, participant.e.s aux formations de l’école de gestion de paix territoriale et aux dialogues multiacteurs.
- Echanges avec les bailleurs : MPN/OSC et Agence à Bogota de l’AFD, et APC
Il appartient aux évaluateurs de proposer le contenu de la mission en Colombie, tout en respectant les critères de sécurité imposés par la situation actuelle. Le périmètre d’intervention sera : les régions de Chocó, la Côte Pacifique, Norte del Cauca et la France. En fonction des difficultés et des contraintes liées à la situation en Colombie, certains de ces entretiens pourront être réalisés à distance (téléphone ou vidéoconférence).
Durée estimée : 20 jours
Phase 3. Rédaction et présentation des rapports
- Rédaction du rapport d’évaluation intermédiaire par l’équipe de consultants ;
- Commentaires des membres du COPIL sur le programme.
- Rédaction et remise du rapport final
- Restitution du rapport final aux membres du programme et aux bailleurs
Durée estimée : 12 jours
Calendrier indicatif : l’appel d’offres sera ouvert jusqu’au 12 octobre 2025. La sélection et contractualisation de l’équipe se fera fin octobre, pour un démarrage de la mission en novembre 2025. Le rapport final est attendu pour le 15 avril 2026 au plus tard. L’équipe de consultant-es fournira un calendrier détaillé dans sa proposition technique et financière, en précisant la répartition des tâches et la durée d’exécution de chaque tâche.
D. Livrables attendus
L’équipe de consultant.e.s fournira les livrables suivants en espagnol.
- Une note de cadrage de l’évaluation de 10 pages maximum, décrivant l’approche/la méthodologie et l’exécution des programmes/le calendrier.
- Un rapport préliminaire avec l’analyse du terrain, les observations et les recommandations (Remise prévue au 15 mars 2026);
- Un rapport final intégrant les commentaires/observations issus des échanges et discussions avec les partenaires du projet (40 à 60 pages maximum hors annexes) + une synthèse de 10 pages maximum (Remise prévue au 15 avril 2026).
- Tous les documents produits pour l’évaluation, y compris les copies papier des rapports et les données brutes sous Excel et Word sous forme électronique.
- Le rapport final devra contenir les rubriques suivantes, sans s’y limiter :
- Page de couverture, table des matières et liste des acronymes
- Résumé intégrant les changements avec mise à jour des données par rapport à chaque indicateur défini (objectifs et indicateurs de résultats tels qu’ils sont énoncés dans le cadre logique).
- Introduction
- Objectifs
- Méthodologie
- Analyse et interprétation (y compris les tableaux/graphiques et le texte) – elle comprendra à la fois l’analyse du processus et l’analyse des résultats/impact (critères du CAD)
- Constatations / Observations
- Meilleures pratiques et leçons apprises
- Conclusion et recommandations
- Annexes comprenant des outils de collecte de données et des ensembles de données
- Études de cas, témoignages et images connexes pour étayer l’analyse
Dès la validation et réception du rapport final complet, celui-ci sera traduit en français par le SCCF pour transmission à l’AFD.
Compte tenu des éléments ci-dessus, il est demandé aux consultants d’inclure dans leur offre de services des propositions détaillées sur la méthodologie qu’ils proposent de mettre en œuvre (étapes de l’évaluation, acteurs consultés, réunions et présentations collectives, méthodologie de collecte des données, documents produits). Les consultants proposeront également, dans leur offre de services, la répartition du nombre de jours de travail dans les différentes phases de l’évaluation (et pour chaque consultant).
E. Budget et paiements
Il est demandé aux consultants de soumettre dans leur offre une proposition de budget détaillée, tenant compte de ces éléments et précisant le nombre de jours travaillés par consultant au total et dans les différentes étapes de l’évaluation : phase de préparation (examen des documents et briefings), phase de terrain (collecte et analyse des données), phase de rédaction du rapport intermédiaire, phase de présentation collective et finalisation, selon la méthodologie et la procédure qu’ils ont proposé pour l’évaluation. Les frais inhérents à l’organisation d’ateliers et d’entretiens collectifs dans chaque région du projet sera pris en charge par le programme. L’équipe de consultants doit cependant détailler dans son budget ses frais de déplacement, alimentation et hébergement dans les 3 régions du projet, qui seront remboursés aux frais rééls sur présentation des justificatifs.
Le mode de paiement sera le suivant :
- Premier versement de 30 % sur présentation de la note de cadrage.
- Deuxième versement de 40% sur présentation du rapport provisoire
- Dernier versement de 30 % après validation du rapport final.
F. Appel d’offres
Seuls les sociétés ou les consultants dument enregistrés auprés de leur administration fiscale peuvent répondre
En cas d’associations de consultants indépendants, la contractualisation et les paiements se feront avec un seul qui aura la responsabilité de la mission
Les propositions techniques et financières devront inclure les éléments suivants :
- Synthèse d’au maximum deux pages résumant les points forts de la proposition et pourquoi elle répond à la demande
- Compréhension des lignes directrices de l’évaluation,
- Présentation approfondie du processus d’évaluation et de la méthode permettant d’atteindre les objectifs de l’évaluation,
- Plan de travail avec un calendrier et une répartition des tâches spécifiques par consultant,
- Proposition de budget, toutes taxes comprises, avec répartition détaillée, et montant et taux de la TVA
- Composition de l’équipe avec les responsabilités spécifiques.
- le CV du consultant ou de l’équipe de consultants mobilisés (si une équipe est proposée, en précisant qui sera le ou la chef.fe de mission). Un.e des consultant.es a minima devra avoir une expertise dans la thématique du genre et des droits des femmes.
- Échantillons de travail : au moins un rapport réalisé par l’équipe proposée dans le cadre d’une enquête/évaluation récente d’un projet de coopération au développement.
- Excellent niveau d’espagnol parlé et écrit, maîtrise du français et/ou de l’anglais appréciée La décision finale sur les appels d’offres sera prise par le Comité de Pilotage du programme.
G. Contacts de référence :
Les réponses à cet appel d’offres devront être soumises en espagnol avant le 12 Octobre 2025 à
dept.personnelappuiexterne@secours-catholique.org,
Et à Jasmine Cozic, Coordinatrice du Programme Ensemble pour la paix :
Vous souhaitez déposer un appel d’offre ?
Déposez vos appels d'offres pour vos recherches de prestations visant à renforcer votre organisation, faciliter vos projets...
Déjà inscrit ?
L’ABC des prestataires
Plus de 50 prestataires référencés dans notre base !
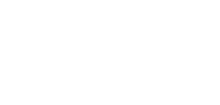
Tout chaud
Nous ne sommes pas des cibles : stop à l’impunité
3 questions à Sophie Lehideux, Membre du comité de décision FRIO
Appel à une transformation de l’action humanitaire