Appel d’offre – Consultant évaluation technique finale projet RESAOLAB
- Présentation de la Fondation
La Fondation Mérieux est une fondation reconnue d’utilité publique créée par Charles Mérieux. Sa mission est de contribuer à la santé globale en renforçant les capacités locales dans les pays en développement afin de réduire l’impact des maladies infectieuses sur les populations vulnérables.
La Fondation intervient dans de plusieurs domaines :
- Accroître l’accès au diagnostic car il est un outil essentiel dans le suivi et la lutte contre les maladies infectieuses ;
- Renforcer les capacités dans le secteur de la recherche, former les équipes locales et développer des programmes de recherche ;
- Echanger et partager des connaissances pour disséminer les avancées médicales ;
- Agir avec/pour la mère et l’enfant, qui sont les plus vulnérables face aux maladies infectieuses.
- Description de RESAOLAB
II.1- Présentation du projet
Le projet RESAOLAB est un projet en trois phases initié par la Fondation Mérieux en 2009, soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD), et en collaboration avec les acteurs de la santé en Afrique de l’Ouest. C’est un projet d’appui institutionnel de l’entité en charge des laboratoires de biologie médicale, les Directions ou Directions (Nationales) en charge des Laboratoires (DL). Les Directions des Laboratoires sont les organes du Ministère de la Santé en charge de définir les stratégies de développement et de soutien des systèmes de laboratoire.
A travers les différentes phases, RESAOLAB a bénéficié d’appuis variés visant à renforcer la gouvernance des systèmes de laboratoire, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité des services de biologie médicale en Afrique de l’Ouest. Au-delà du projet, RESAOLAB est un réseau de collaborations et d’échanges entre les pays membres.
Le projet a entamé sa troisième phase en octobre 2019 en soutien à sept pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo pour une durée supposée de 4 ans. Cette troisième phase s’est inscrite dans la continuité des deux premières avec un appui à la structuration des DL et dans une volonté de travailler sur la pérennisation du réseau RESAOLAB. La conduite de cette dernière phase a été fortement perturbée par la géopolitique et les crises sanitaires. En effet, ces différents événements ont conduit à l’ajout d’une activité de réponse au Covid-19 et à l’arrêt des financements au Burkina Faso, au Niger et au Mali. En accord avec l’AFD, le projet a bénéficié d’une prorogation, avec une date d’achèvement technique dans les pays au 31 décembre 2025 et une clôture du projet au 31 mars 2026.
De plus, RESAOLAB a pour vocation de créer une dynamique régionale permettant les échanges de pratiques entre entités en charge des laboratoires dans les différents pays membres du projet.
II.2- Objectifs du projet
Objectif global :
Les populations utilisent les laboratoires qui offrent un service de qualité et de proximité
Objectifs spécifiques :
OS1 : Les politiques nationales de développement de la biologie médicale sont définies, mises en œuvre et harmonisées au niveau régional.
OS2 : La qualité du diagnostic biologique est améliorée pour répondre aux besoins de la population, selon les standards internationaux et contribue aux outils globaux de la surveillance des épidémies
II.3- Résultats attendus
OS1 :
R1. Les politiques de développement et conditions d’exercice du diagnostic biologique sont clairement définies, adoptées et appliquées dans chacun des 7 pays en tenant compte du RSI et des objectifs du développement durable
R2. Les DL pilotent efficacement le réseau national des laboratoires (en capacité de piloter (coordonner, planifier, informer, suivre la récolte les données, traiter et analyser les données) en cohérence avec la PNL.
R3. Les systèmes de laboratoires sont fonctionnels* et harmonisés régionalement
R4. La surveillance basée sur le laboratoire est fonctionnelle dans les pays (RSI et GLASS)
OS2 :
R5. Les laboratoires nationaux de référence VIH et TB ont bénéficié d’un audit et de recommandations quant à leur développement
R6. Les équipes de coordination et de mise en œuvre du plan de riposte à l’épidémie COVID 19 volet laboratoire piloté par les DL sont soutenus
II.4- Activités du projet
OS1 :
A1 : Elaborer/réviser des documents normatifs, réglementaires et des plans d’actions du secteur de la biologie médicale
A2 : Renforcer les capacités opérationnelles des DL et appuyer la réflexion sur leurs mécanismes de financement et pérennisation
A2.1 : Appui au fonctionnement des DLs
A2.2 : Renforcement du management de la qualité
A2.3 : Mise en œuvre des plans de formation continue
A2.4 : Renforcement des capacités des réseaux de laboratoires
A3 : Soutenir une dynamique d’échanges inter pays pour l’harmonisation régionale de l’exercice de la biologie médicale
OS2 :
A4 : Formation et équipement des DL pour participer à la surveillance de la RAM
A5 : Amélioration de l’accès et de la qualité du suivi biologique pour le VIH et la TB dans les 7 pays
A5.1 : Etat des lieux du suivi biologique du VIH et de la TB
A5.2 : Révision et/ou définition d’une stratégie laboratoire pour le suivi biologique du VIH/TB en lien avec les programmes nationaux et LNR
A6 : Renforcer les capacités du personnel de laboratoire et des prescripteurs
A00 : Mobilisation du réseau pour la réponse à la crise SARS/COVID
- Evaluation
III.1- Justification et objet de l’évaluation
Dans la convention de subvention signée en 2019 avec l’AFD, il est stipulé que la fin du projet doit s’accompagner de l’évaluation finale du projet. Celle-ci nécessite l’intervention d’un consultant externe en charge de mesurer l’atteinte des objectifs au regard des indicateurs et également d‘évaluer et de valoriser l’impact du projet RESAOLAB.
L’évaluation a pour objectif de :
- Évaluer dans quelle mesure les objectifs du projet ont été atteints,
- Définir comment le projet a contribué aux changements observés,
- Évaluer dans quelle mesure le travail avec une approche en réseau a contribué aux résultats du projet.
Il est important de souligner que la phase 3 du projet RESAOLAB a été largement impactée par les crises politiques et sanitaires. En effet, les différentes crises géopolitiques ont conduit à l’arrêt des financements au Burkina-Faso, au Mali et au Niger, et la crise du Covid-19 à de nombreux réajustements d’activités. Il est donc attendu de l’évaluation d’identifier les facteurs ayant permis au projet de s’adapter et de contribuer aux changements dans les pays à long terme (renforcement système de laboratoire, pérennisation des Directions des Laboratoires).
- Les évaluateurs se doivent également de conduire leur évaluation en suivant les critères définis par l’OCDE[1], le focus sera fait sur la cohérence, l’efficacité et la durabilité : Pertinence : (l’intervention fait-elle les bonnes choses ?)
- En quoi une action de renforcement de systèmes de laboratoires s’inscrit-elle dans le renforcement des systèmes de santé ?
- Cohérence : (dans quelle mesure l’intervention est-elle adaptée ?)
- Comment RESAOLAB 3 s’est aligné avec les plans nationaux des pays, en complémentarité avec les autres actions et financements en place ?
- Compte tenu des crises géopolitiques et sanitaire, comment RESAOLAB 3 a su s’adapter aux différents contextes ?
- RESAOLAB 3 est un projet régional, néanmoins, les besoins de chaque pays ne sont pas les mêmes, comment RESAOLAB 3 a su répondre aux besoins de chaque pays tout en gardant son approche réseau ?
- Efficacité : (l’intervention atteint-elle ses objectifs ?)
- RESAOLAB 3 a-t-il atteint les indicateurs de projet ?
- Plus largement, en incluant l’approche réseau, RESAOLAB 3 a-t-il contribué à construire une zone d’échanges et de partage des bonnes pratiques ?
- Dans quelle mesure les objectifs atteints ont généré les résultats attendus ?
- Efficience :(dans quelle mesure les ressources sont-elles bien utilisées ?)
- Comment RESAOLAB 3 a réussi à adapter ses ressources financières et humaines aux différentes crises et aux prorogations de projet ?
- Comment RESAOLAB a réussi à contribuer à la logique d’intervention entre PTFs pour une optimisation des ressources disponibles dans les pays ?
- Impact :(quelle différence l’intervention fait-elle ?)
- Dans quelle mesure RESAOLAB 3 contribue à l’amélioration de la gouvernance des Directions des Laboratoires ou structures équivalentes ?
- Comment RESAOLAB 3 a contribué au renforcement de capacités du personnel de laboratoire ?
- Durabilité :(les bénéfices dureront-ils ?)
- Dans quelle mesure RESAOLAB 3 a contribué à la construction du réseau RESAOLAB en lui donnant les ressources nécessaires à sa pérennité ?
- Comment RESAOLAB 3 a soutenu les Directions des Laboratoires ou équivalent dans leur structuration leur permettant l’accès à de nouveaux financements domestiques et externes ?
- Quels sont les facteurs clés contribuant à la pérennisation des résultats du projet ?
III-2 Méthodologie attendue
Il est attendu que les évaluateurs utilisent la méthodologie de l’Evaluation de contribution (EC) pour conduire l’évaluation finale du projet. La volonté d’utiliser la méthode EC se justifie par l’approche programme dans laquelle s’inscrivent les différentes phases de RESAOLAB et dans la volonté de mesurer comment RESAOLAB 3 a pu contribuer aux changements observés en prenant en considération des facteurs pouvant influencer ces résultats.
Les grandes étapes de l’EC sont :
- Définir la question d’évaluation
- Documenter les changements observés (élaboration des chaînes de causalité)
- Identifier les facteurs externes pouvant influencer les effets identifiés
- Collecter des données
- Construire une narration de contribution
III-3 Préparation de l’évaluation
Cette étape permet au consultant de rassembler les informations nécessaires sur le projet pour conduire son évaluation. Le consultant doit notamment :
- Prendre connaissance des documents projet RESAOLAB 3 ainsi que ceux des phases précédentes. Les documents à consulter seront rendus disponibles par la Fondation Mérieux.
- Soumettre une note de cadrage qui sera validée par la Fondation Mérieux
- Prendre contact avec les personnes en charge de l’implémentation du projet (liste des personnes à formaliser avec la Fondation Mérieux). L’équipe comprendra :
- L’équipe projet internationale,
- L’équipe des Directions des Laboratoires,
- Les bénéficiaires directes (anciens boursiers DES, DU-Antibio, formés de l’EPAC, AfroACDX…
- Les bénéficiaires indirects (institutions).
- Les partenaires techniques et financiers (AFD et Fonds Mondial en priorité, puis autre à définir)
IV – Déroulée de l’évaluation
IV – 1 Profil du consultant
Il est attendu que le consultant en charge de l’évaluation ait :
- Des connaissances et expériences dans la conduite d’évaluation de projets de développement financés par des bailleurs de fonds ;
- De l’expérience dans la coopération internationale ;
- Des connaissances et expériences dans les projets de santé et de gouvernance ;
- De la connaissance et expérience en Afrique de l’Ouest ;
- De la connaissance et expérience en évaluation mobilisant des méthodologies qualitatives notamment l’utilisation d’outils d’analyse de données appropriés.
Les propositions ne respectant pas le profil demandé ne seront pas traitées.
IV-2 Durée de l’évaluation
La durée totale de l’évaluation est estimée à trois mois à compter du 1er novembre 2025 qui peuvent être divisés comme suit :
- Préparation de l’évaluation : documentation du projet et co-rédaction de la note de cadrage avec la Fondation Mérieux ;
- Collecte de données qui devra comprendre des visites terrain, une analyse des données et draft du rapport d’évaluation. Ces résultats seront présentés lors de l’atelier de restitution ;
- Séance de restitution ;
- Reporting : rédaction du rapport en intégrant les commentaires de l’atelier de restitution.
Le consultant devra présenter un chronogramme détaillé dans son offre technique. L’évaluation commencera à la signature du contrat par le consultant et la Fondation Mérieux.
IV-3 Document à soumettre par le consultant
Pour répondre à l’appel à consultance, le consultant doit envoyer :
- Une proposition technique :
- La méthodologie pour évaluer les différents aspects du projet, incluant les questions utilisées pour conduire l’évaluation, les outils proposés, un chronogramme et un CV.
- Une proposition financière détaillée (honoraires, perdiems, transport, …) incluant la méthode de paiement souhaitée.
Les cabinets d’étude ou consultants individuels intéressés doivent fournir un dossier de candidature démontrant leurs compétences et qualifications pour réaliser efficacement la mission décrite dans la partie III. Les propositions financières ne devront pas excéder le budget maximum de 60 0000€ TTC.
Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 22 septembre 2025 par email à :
Vous souhaitez déposer un appel d’offre ?
Déposez vos appels d'offres pour vos recherches de prestations visant à renforcer votre organisation, faciliter vos projets...
Déjà inscrit ?
L’ABC des prestataires
Plus de 50 prestataires référencés dans notre base !
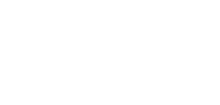
Tout chaud
Nous ne sommes pas des cibles : stop à l’impunité
3 questions à Sophie Lehideux, Membre du comité de décision FRIO
Appel à une transformation de l’action humanitaire